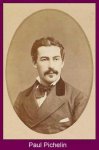La famille Pichelin
mercredi 28 septembre 2022 , par
La famille Pichelin
Famille Pichelin
Famille généreuse et bienfaitrice pour la commune de "Les Touches"
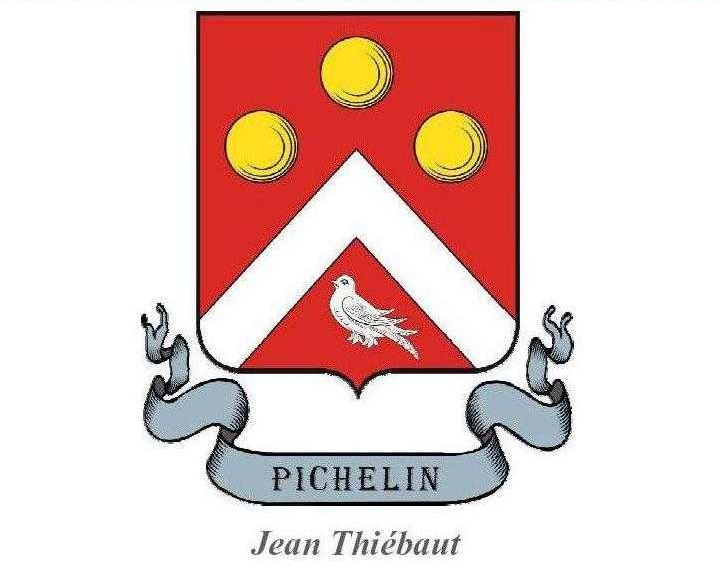
- Blason de la famille Pichelin
Origine des Pichelin
Les racines de la famille Pichelin se trouvent à Trans, Joué, Nort et Les Touches. C’est dans ces 4 communes que pendant 450 ans, de 1490 à 1936, vont vivre les Pichelin, en résidence principale jusqu’en 1700 puis secondaire, lorsqu’ils s’installeront à Nantes.
Louis Pichelin sera le premier de cette famille à s’installer aux Touches vers 1640, au logis dit "de la Chapelle" et acquiert des biens sur la commune.
Le 27 juin 1684, il achète le Corps de Garde qui deviendra la maison familiale des Pichelin.
Le 13 octobre 1815, le roi Louis XVIII nomme Jean-Marie Pichelin maire de la comme Les Touches, il le restera jusqu’en 1830.
Source : Jean Thiébaut, Historien de la famille Pichelin
Le Corps de Garde a été la maison familiale des Pichelin de 1684 à 1936. Mme Marguerite Allotte de la Fuÿe née Marguerite Pichelin, passa sa jeunesse avec ses cousines au Corps de Garde. Biographe de son oncle Jules Verne, elle écrivait aussi des pièces de Théâtre.
En 1849, Clémence Pichelin fait don à la commune d’une parcelle de son jardin au Nord de l’église pour la construction de la nouvelle église. Le 13 septembre 1858 elle s’engage à céder du terrain à la commune pour la construction de la mairie et maison d’école. Le 2 décembre 1858 elle promet de céder du terrain à condition que ce terrain soit employé pour la construction du Presbytère.
Concession Pichelin dans le cimetière des Touches comportant deux tombes
Une concession perpétuelle valait 68 francs, soit l’équivalent d’un bœuf de labour. La famille Pichelin a achetée la première concession avec 2 tombes, le maire de l’époque étant Jean-Marie Pichelin, il se devait de donner l’exemple et il s’agit de la tombe de sa veuve !.. Lui-même ayant été enterré à Nantes.
Sur la tombe de gauche nous pouvons lire :
Dame Lucie Mazureau Ve de Mr J.M. Pichelin, décédée le 2 juillet 1852
Sur la tombe de droite nous lisons :
Mlle Clémence Pichelin décédée le 22 décembre 1872.
Les personnes au service de la famille Pichelin n’ayant pas de proche parent, étaient enterrées dans le caveau Pichelin, en remerciements des services dévoués.
Ce fut le cas aux Touches pour Léontine Carudel décédée le 19 avril 1911 et sa sœur Louise décédée le 13 février 1948.
Afin d’assurer la pérennité du tombeau de cette famille pour son attitude généreuse, le 15 juillet 2010 la commune des Touches s’est engagée à entretenir le tombeau de la famille Pichelin, dans le cimetière de notre cité.
- En souvenir d’une famille généreuse et bienfaitrice pour la commune de "Les Touches", Henri Lepage Août 2017 -
... Il y avait le petit cimetière qui entourait la vieille église, à cet emplacement on a construit la nouvelle église vers 1850, elle sera agrandie en 1895.
Le grand cimetière, qui existait déjà avant 1771, était au calvaire, sa surface sera doublée en Janvier 1887, c’est celui que nous connaissons aujourd’hui.
Une concession perpétuelle valait 68 francs, soit l’équivalent d’un boeuf de labour.
La famille Pichelin acheta la première concession...
Il existe encore une concession Pichelin dans le cimetière actuel comportant 2 tombes : s’agit-il de cette "première" concession ?. Très vraisemblablement à cause des concordances des dates. En outre le maire de l’époque étant Jean-Marie Pichelin, il se devait de donner l’exemple et il s’agit de la tombe de sa veuve ! ... Lui-même ayant été enterré à Nantes, suite à une chute de cheval.
Sur la tombe de gauche nous pouvons effectivement encore y lire :
Ici gît le corps de DAME Luce MAZUREAU Ve de Mr J.M. Pichelin,
née à Nantes le 22.10.1783. Décédée aux TOUCHES le 2 Juillet 1852.
REQUIEM ETERNAM DONA EI DOMINE
Sur la tombe de droite nous lisons :
Mlle CLEMENCE Fçoise PICHELIN DECEDEE LE 22 Xbre 1872 dans sa 61e année.
REQUIEM ETERNAM DONA EI DOMINE.
Sur la croix de la tombe de Clémence il y a une plaque au nom de Léontine Carudel
Il y a une surprise, car sur la croix de la tombe de Clémence, on distingue aussi une plaque plus récente : Léontine CARUDEL, pieusement décédée le 19 Avril 1911.
On retrouve là une très fidèle cuisinière de la famille de Pitre Pichelin (1814-1905) le fils de notre maire Jean-Marie Pichelin. Elle était native des Touches, exerçant dans leur propriété au Sud de Nantes. Elle est largement citée dans le "Mémorial Pichelin" écrit par la fameuse biographe de son cousin Jules Verne, Marguerite Allote de la Fuÿe, née Pichelin (1874-1969). Très populaire dans la famille qu’elle chouchoutait, Léontine a été honorée par une gravure de Michel Noury (1912-1986), le célèbre peintre Nantais fils de Louise Pichelin, à même la porte de "sa" cuisine.
Après recherches, il n’y a aucun doute sur le fait que Louise Carudel soit enterrée avec sa sœur
D’après des recherches faites en Février 2011, pour les descendants des familles Rabine et Lepage, il n’y a aucun doute sur le fait que Louise Carudel, née le 11 Octobre 1860 et décédée le 13 Février 1948, soit enterrée avec sa sœur Léontine, née le 19 Février 1860 et décédée le 19 Avril 1911, dans la concession Pichelin.
Sur cette tombe, en plus des inscriptions pour les membres de la famille Pichelin, il y à une plaque au nom de Léontine Carudel, mais pas de plaque pour sa sœur Louise, et aucune trace en Mairie, de l’emplacement de sa sépulture dans le cimetière des Touches.
Louise Carudel, comme sa sœur Léontine, ayant été au service de la famille Pichelin, a bénéficié d’un logement gratuit jusqu’à son décès.
Pour l’historien de la famille Pichelin, ce serait tout a fait logique que les deux sœurs soient enterrées ensemble, dans la concession Pichelin.
Le 18 Mars 2011, l’oubli a été réparé, il y a maintenant aussi, une plaque au nom de Louise Carudel.
| Prénom | Nom | Naissance | Décès | Époux : prénom | Époux : nom | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Marie | Pichelin du Clairay | 1771 | 1831 | Luce | Mazureau | 1785 | 1852 | |
| 1ère génération | |||||||||
| Luce | Pichelin | 1811 | 1885 | Emile | Burot de L’Isle-Chalans | 1800 | 1870 | ||
| 2 | Clémence | Pichelin | 1812 | 1872 | |||||
| Julien | Pichelin | 1813 | 1829 | ||||||
| 3 | Pierre | Pichelin dit "Pitre" | 1814 | 1905 | Mathilde | Trottier | 1825 | 1918 | |
| 2ème génération | |||||||||
| Marie | Pichelin | 1845 | 1885 | ||||||
| Pierre | Pichelin | 1847 | 1921 | Elisabeth | Jegou d’Herbeline | 1849 | 1934 | 6 | |
| 4 | Paul | Pichelin | 1849 | 1932 | Juliette | Rousselot | 1854 | 1935 | 5 |
| Elisabeth | Pichelin | 1853 | 1884 | Léon | Bonamy | 1847 | 1881 | ||
| 3ème génération | |||||||||
| Marie-Anne | Pichelin | 1873 | 1962 | Edouard | Julliot de la Morandière | 1868 | 1951 | ||
| 7 | Marguerite | Pichelin | 1874 | 1959 | Louis | Allote de la Fuÿe | 1872 | 1896 | |
| Louise | Pichelin | 1875 | 1930 | Edouard | Noury | 1863 | 1939 | ||
| Pierre | Pichelin | 1878 | 1870 | Madeleine | du Crest de Villeneuve | 1891 | 1979 | ||
| Elisabeth | Pichelin | 1877 | 1879 | ||||||
| Thérèse | Pichelin | 1881 | 1942 | Georges | le Masne de Chermont | 1872 | 1955 | ||
| Cécile | Pichelin | 1884 | 1931 | Religieuse | du Sacré-Coeur | ||||
| Jean | Pichelin | 1886 | 1966 | ||||||
| Jacques | Pichelin | 1888 | 1891 | ||||||
| Bénédicte | Pichelin | 1895 | 1973 | Jean | Feildel | 1892 | 1972 |
- Jean Marie Pichelin du Clairay, Maire des Touches 1815 - 1830
- Clémence Pichelin, fondatrice de l’école du Sacré Cœur en 1840, fille de Jean Marie
- Pierre Pichelin dit "Pitre", héritier de sa sœur Clémence
- Paul Pichelin, héritier de son père "Pitre", il cédera le "Corps de Garde" à faible prix
- Juliette Rousselot, femme de Paul Pichelin
- Elisabeth Jegou d’Herbeline a peint l’aquarelle de l’ancien clocher de l’église
- Marguerite Allotte de la Fuÿe, née Pichelin, est la nièce de Jules Verne, qui est cousin germain de son beau-père, Maurice Allotte de la Fuÿe. Voir l’extrait du "Mémorial" de Marguerite Allotte de la Fuÿe : "Flâneries Tuchides"
voir aussi la généalogie de Paul Pichelin par Jean Thiebaut sur Geneanet

- Aquarelle de l’ancien clocher église des Touches, peinte par Elisabeth Pichelin, née Jegou d’Herbeline
L’histoire de l’école des filles
L’histoire de l’école des filles
Collaboration Henri Lepage et Jean Thiébaut
Un bel exemple de solidarité Communale
Délibération du Conseil Municipal des Touches
Session de Février 1874
L’an mil huit cent soixante quatorze, le dix- neuf février, les membres composant le Conseil municipal de la Commune des Touches se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances.
Étaient présents M. Jourdan François, Rialland Jean, Peigné Henri, Bourré Jean, Cruaud Julien, Bourgeois René, Pelé Alexandre, Rigaud Louis, Fairrand Julien, Marchand François, Nouais Marc, Pelletier Pierre, Maire
Lesquels formant la majorité peuvent valablement délibérer.
Monsieur le Maire, ayant déclaré la séance ouverte, a fait l’appel nominatif et a invité l’assemblée à choisir un Secrétaire.
Monsieur Peigné ayant obtenu la majorité des suffrages a accepté et pris place au bureau.
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’une lettre de M. le Sous-Préfet en date du 13Décembre 1873 dans laquelle il est dit que par testament en date du 30 Octobre 1872, Mlle Pichelin [1] a légué à la Fabrique de la Commune des Touches une maison avec dépendances pour être affectée à une école de filles dirigée par les Sœurs. Monsieur le Maire pose au Conseil que la Commune devant recueillir un bénéfice de cette libéralité, il est nécessaire que le Conseil municipal soit appelé à délibérer sur son acceptation
Le Conseil, après avoir mûrement délibéré a été d’avis unanime d’accepter cette libéralité : mais à la condition expresse que les Sœurs soient tenues de recevoir à leur école les petites filles indigentes de la commune. Le Conseil avait insisté sur cette admission gratuite des enfants pauvres, pour la raison que l’école a été construite grâce, principalement à la libéralité de Mlle Pichelin, mais aussi à celles des habitants de la Commune qui ont contribué à son érection, soit par dons en argent, soit par dons en nature, charrois, matériaux etc...
Qu’en est-il de cette "condition expresse" fixée par nos aïeux ? Cette "clause" est-elle encore applicable de nos jours au bénéfice des "petites filles" défavorisées de la Commune ?
Le point de vue d’un historien de la famille Pichelin
Cette histoire est assez extraordinaire et mérite qu’on s’y attarde cinq minutes.
Nous ne savons pas si le Sacré-Cœur respecte encore, où non, cette clause, mais c’est probable car beaucoup d’écoles libres adoptent d’elles-mêmes cette démarche charitable Sans y être obligées...
Quoi qu’il en soit, seul le Conseil d’État, pouvait délier cette École de l’obligation faite par le Conseil Municipal en 1874... mais, les voies du Seigneur étant impénétrables et à défaut de Conseil d’État, il n’est pas impossible qu’une loi s’en soit chargé au début du siècle... suivez nous si vous le Voulez bien.
L’école des filles a été créée aux Touches en 1840, par les Tertiaires du Carmel d’Avranches-Coutances. Elle se tenait quelque part dans le Bourg, dans une maison appartenant vraisemblablement à la famille Pichelin. En effet, dès le 18 mars 1846, un arrêté municipal fait allusion à leur"... maison servant aujourd’hui d’école de filles..."
En 1850, 1854 et 1867 de nouvelles lois, encore en vigueur dans les années 1874, réglementent l’enseignement et donnent au préfet le droit de nomination des maitres, selon le vœu exprimé par le Conseil Municipal. Mais ceci ne concernait que les institutions communales et non les écoles libres (qui restaient autorisées).
A l’époque on pouvait donc trouver 3 cas de figure, en matière de statut d’école.
- cas n°1 : les écoles communales, avec des instituteurs laïcs, sous la responsabilité du Conseil Municipal,
- cas n°2 : les écoles communales, avec des Sœurs enseignantes, sous la responsabilité du Conseil Municipal,
- cas n°3 : des écoles libres, administrées par des Sœurs mais, comme je le suppose, créées avec l’autorisation du Conseil Municipal.
Entre 1850 et 1872, pour améliorer les conditions matérielles de l’École des Filles, Clémence Pichelin, aidée par des habitants de la Commune, fait édifier un bâtiment sur un terrain lui appartenant. L’école est encore administrée à cette époque, par des Sœurs du Tiers-Ordre des Carmélites.
Tout se passe dans le meilleur esprit entre la commune et la Paroisse, puisque le 25 Août 1867, suite à la promulgation de la loi du 10 avril 1867 qui permet aux communes de développer la gratuité de l’école primaire pour les pauvres, et rend obligatoire l’ouverture d’une école de filles dans les communes de plus de 500 habitants, le Conseil Municipal des Touches demande à être "dispensé de la création d’une école publique de filles pour la raison que celle qui est dirigée par les sœurs du tiers-ordre des Carmélites, suffit entièrement au besoin de l’instruction pour les filles”.
Apparemment la requête du Conseil a été acceptée par le Préfet puisqu’il n’est pas créé d’école communale de filles, aux Touches, et que les crédits de la commune peuvent être consacrés à l’école communale des garçons et des"adultes”.
En octobre 1872, Clémence Pichelin , sentant sa fin Venir, concrétise par un testament dûment enregistré par le notaire de Nort son don à la Fabrique de la maison, du terrain et des dépendances utilisés par l’école des filles. Ce legs est consenti à la condition expresse, que cette École soit toujours administrée par des religieuses. Si cette condition venait à ne pas être respectée, l’ensemble des biens donnés devraient être rendus à ses héritiers.
Puis, son œuvre accomplie, Clémence s’endort le 22 décembre dans la paix du Seigneur.
C’est alors, au cours de l’année 1873, qu’un débat s’engagea entre l’Évêque et le Préfet, pour déterminer si, compte tenu de la clause exigée par Clémence, le legs était ou non recevable et, si oui, dans quelles conditions ?
- Dans la mesure où la "nouvelle école", résultant du don, serait une école libre la condition mise par Clémence Pichelin était, pour l’évêché de Nantes, parfaitement acceptable.
- Mais, si cette école avait vocation à devenir communale, le Préfet ne voulait pas obérer l’avenir en s’interdisant de nommer ‘un jour’ des instituteurs ou institutrices laïcs...
Finalement c’est le Maréchal de Mac-Mahon qui en tant que Président de la République a tranché la question en signant un décret en date du 11 mai 1874, sur rapport du Conseil d’État.
Ce décret établit que la Fabrique est autorisée à accepter le legs de Mile Pichelin pour faire une école Congréganiste de filles, (c’est à dire libre), mais ce décret précise
... que cela doit-être fait "aux clauses et conditions imposées", avec des Sœurs appartenant à une "Congrégation vouée à l’enseignement et légalement reconnue"...
Comme il n’est pas précisé de restriction sur les clauses évoquées : celles posées par Clémence Pichelin dans son testament, celle posée par le Conseil Municipal en séance du 18 février 1874, où l’ensemble de toutes ces clauses, il est évident qu’il s’agit, en Droit, de l’ensemble des conditions exprimées avant la date du décret !
En conclusion, seul un nouvel arrêt du Conseil d’État pourrait donc délier l’école, le Sacré-Cœur, de son obligation exprimée par le Conseil Municipal d’accueillir gratuitement les petites filles pauvres de la Commune des Touches !
Sans vouloir retirer quelque mérite que ce soit au Conseil, cette condition qu’il a posé ne semble pas tout à fait désintéressée. Elle était dans la logique de la dispense demandée en août 1867, par laquelle la Commune pouvait renoncer à fonder une école communale de files dans la mesure où l’obligation de la gratuité de l’enseignement aux pauvres, imposée par la loi de 1867, serait assumée par le Sacré-cœur. Le transfert de cette charge sur l’école libre. permettait à la Commune de consacrer ses fonds à l’école des garçons...
On notera également que. dans son décret, le Président utilise le terme de "fondation".
Cette obligation faite à la fondation "Le Sacré-Cœur" n’est pas un cas isolé. Elle na rien d’exceptionnel. La famille ROTHSCHILD, à fait don en son temps d’un terrain boulevard Picpus, à Paris, pour permettre la création d’un hôpital, l’Hôpital Rothschild, avec obligation de garder 2 lits disponibles en permanence pour les juifs nécessiteux. Je crois que cette obligation est encore respectée bien que cet hôpital ait été depuis intégré à l’Assistance Publique de Paris ! A contrario, l’Institut de France qui n’a pas su respecter les conditions du legs fait par Etienne-Jules Marey. a dû rendre, à ses héritiers, son terrain de Roland Garros à Boulogne-Billancourt.
Mais, qu’en est-il des conditions exprimées par Clémence dans son testament ?
Pour commencer, rappelons ces fameuses clauses :
...Je donne et lègue à la Fabrique des Touches, la maison que j’ai fait construite ...[ ]... à condition que cette maison conserve toujours la destination que je lui ai donnée et qu’il y soit toujours entretenu une école de files, tenue par des religieuses et non par des institutrices laïques.
Si cette condition n’était pas remplie, je veux et entends que mes héritiers rentrent dans la propriété des immeubles que je viens de léguer, à charge à eux de rembourser aux personnes qui ont souscrit pour la construction de ces bâtiments , ou à leurs héritiers, le montant de leur souscription selon les intentions exprimées par elles en souscrivant...
Ces conditions exprimée par Clémence, sont d’une tout autre nature que celle exprimée par le Conseil Municipal. Elles sont constitutives de l’acte de donation et, à ce titre elles sont intangibles, même en Conseil d’État
Que peut-on en dire aujourd’hui ?
Il est clair que ces clauses ne sont plus respectées dans "la forme", puisque le Sacré-Cœur est devenu une école mixte, et que les administrateurs et les enseignants sont devenus des laïcs.
Mais ces modifications, intervenues au fil du temps et de la législation, ne résultent pas d’une Volonté des légataires de déroger aux vœux de Clémence, mais d’un processus qui les dépasse, et auquel, même Clémence, aurait dû se soumettre
Les héritiers de Clémence considèrent donc que sur l’essentiel, et sur le "fond", la volonté de Clémence est encore respectée, puisque les petites-filles de la Commune disposent d’un Enseignement Libre. Et l’école, même dans sa structure actuelle, correspond bien au vœu de leur lointaine Grande-Tante.
Trop soucieux de respecter la Volonté de leur Aïeule, animé de sentiments amicaux vis à Vis de la Paroisse, de la Commune des Touches et de l’Enseignement Libre, le petit millier d’héritiers vivants de Clémence ne cherchera certainement pas à remettre en cause la validité du legs !
Et la suite de l’histoire ?
En octobre 1874, le Sous-préfet, se retranchant derrière la Commission Départementale, demande (entre autres considérations relatives à l’école des garçons) que l’École libre des filles soit déclarée communale.
D’après ce que nous en avons compris, et sous toute réserve, le Conseil prétend ne pas y "voir d’inconvénient’ mais impose 2 conditions dilatoires :
La Directrice, Sœur Sainte-Aimée devra produire au Maire une “demande régulière” pour devenir institutrice laïque, avec une autorisation de sa Supérieure du Tiers Ordre du Carmel d’Avranches.
Le Maire et son adjoint protestent officiellement contre cette délibération dont le but n’est, selon eux, que de retarder la remise en ordre des choses. Ils demandent au Préfet de passer outre et d’appliquer la décision de la Commission Départementale.
Mais le Maire explique que la Commune , faute de ressources, de salle, de meubles ne peut rien changer à la situation existante, que la maison actuelle, la seule disponible, appartient à la Fabrique et que la Sœur enseignante donne toute satisfaction. Il demande donc de laisser les choses en l’état, mais que la Commission Départementale :
- déclare "École Communale", l’école jusqu’ici libre des Touches,
- nomme Sœur Sainte- Aimée comme" institutrice communale",
- lui (?) donne l’allocation de traitement de 200 francs,
- verse l’allocation de 75 centimes pour enfant pauvre.
Finalement, il semble qu’en cette fin d’année 1874, la situation du statut de l’école restait un peu confuse puisque, en 1875, on parlait encore indifféremment de "l’école communale des filles" ou de "l’école des Sœurs" !
Qui plus est, le Conseil délibérera encore pour savoir, qui de la Commission Départementale où de la Fabrique doit prendre en charge les enfants indigents, la Commune estimant que ce n’était pas à elle de le faire.
Nous ne savons pas combien d’années perdurera ce mélange des genres qui, dans le fond, devait arranger tout le monde car il y avait manifestement une bonne entente entre la Paroisse et la Commune des Touches.
Ce qui est certain c’est qu’il a bien fallu qu’un jour la situation soit réglée et que l’école récupère un vrai statut d’École Libre, puisque c’était le sien dans les années 1910.
En fait cela s’est produit à l’occasion des évènements de 1906 qui ont permis de bien séparer les activités de l’Église de celle de l’État.
En effet ... Le 9 décembre 1905 le député Aristide Briand fait voter la loi de séparation des Églises et de l’État...
Les conséquences de cette loi furent multiples. En particulier :
- Les Fabriques disparurent et il fallut attendre 1924 que les diocèses veuillent bien s’organiser pour la gestion des biens des paroisses.
- Les Sœurs furent autorisées à poursuivre leur enseignement à condition de renoncer officiellement à leurs Vœux. Pour les distinguer, ces religieuses furent appelées des "religieuses sécularisées", et les enfants des écoles les surnommaient affectueusement, "les Sécula”...Quant aux Touches, nous savons qu’il y a dû avoir alors, en 1906, des problèmes entre la Paroisse et l’État au sujet de l’école des filles, mais nous ne connaissons pas les détails de cette histoire. Les avocats Pichelin, il y en avait 2 à cette époque, intervinrent pour défendre l’école. Celle-ci, apparemment, surmonta victorieusement la crise, puisqu’elle est encore bien vivante.
Grâce à la récente découverte, dans nos archives municipales, des Bulletins Paroissiaux de l’époque nous pouvons aujourd’hui soulever, pour vous, un coin du voile sur ces évènements.
Bien que tout ait été financé "depuis 29 ans" par des dons, par la Fabrique, par la Paroisse car la Commune n’ avait jamais rien payé pour cette école, le Sacré-cœur avait bien, en 1905, un statut "d’école communale" mais de nature religieuse, comme on l’a expliqué précédemment.
A ce titre le 1er décembre 1906, sous prétexte d’appliquer la loi d’Aristide Briand, le Conseil décida de renvoyer les Sœurs et de fermer l’école. Devant la révolte des habitants et l’action en justice menée avec l’aide des avocats Pichelin, l’Inspecteur d’Académie autorisa le 7 janvier l’ouverture de l’École, en tant qu’"École Libre", pour le 7 février 1907, sous la direction de Mademoiselle LHOMER Maria Philomène.
Apparemment les opposants ne désarmèrent pas, car une cabale fut montée, prétextant que l’eau du puits de l’école était mauvaise, qu’elle rendait les enfants malades et que l’école devait donc rester fermée.
Une pétition des partisans de l’École Libre, s’élevant contre cette iniquité recueillit 380 signatures, ce qui était énorme pour un tel village, et finalement le 23 Juin 1907, Monsieur le Curé put annoncer la réouverture de l’école.
Néanmoins, comme la loi de 1905 avait pour but de réorganiser totalement les relations entre l’Église et l’État en établissant une stricte séparation de leurs activités respectives, nous sommes en droit de penser que cette loi annulait "ipso facto" la clause d’accueillir “gratuitement les petites filles pauvres”, imposée en 1874 par le Conseil Municipal à l’École des filles .
En toute logique, il appartenait désormais à la Commune d’assumer sa responsabilité, c’est à dire de mettre l’enseignement gratuit à la portée de tous les enfants de la commune.
Comment cela s’est-il concrétisé ?
- La clause de 1874 a-t-elle effectivement été rendue caduque par la loi de 1905 ?
- La Commune a-t-elle accueilli des filles dans son école communale de garçons ?
- À- t-elle créé une école communale de filles ou a-t-elle passé un accord avec le Sacré-cœur ?
- Qui, et comment, a pris en charge la scolarité des petites filles pauvres à partir de 1906 ?
Nous ne connaissons pas les réponses à ces questions.
Tout ce que nous pouvons dire c’est que l’École Libre des Touches a poursuivi la route tracée depuis près d’un siècle.
Son existence devait être bien modeste car on peut lire ceci, dans les annales de la Congrégation des Sœurs de Saint-Gildas, relatives à l’année 1932 :
L’école libre des Touches était dirigée depuis près de 40 ans, par une sœur religieuse sécularisée des Sœurs de Coutances. Âgée de plus de 80 ans et ne pouvant remplir son poste, elle rentra à sa Communauté et ses supérieurs avertirent Mr le Curé qu’ils n’avaient personne pour la remplacer. Alors il demanda deux sœurs à Saint-Gildas, l’une pour diriger son école, l’autre pour faire la cuisine.
Comme adjointe, la nouvelle directrice aurait une ancienne religieuse sécularisée de Torfou qui, depuis 17 ans, faisait la classe aux Touches, sa paroisse natale, et était très estimée de la population. Les conditions furent acceptées. La maison, fort ancienne, en mauvais état, fut rajeunie. Le vicaire de la paroisse, très dévoué, fit blanchir, nettoyer, peindre. Il fit appel au dévouement des jeunes filles ; elle s’employèrent au nettoyage de la maison qui, bientôt, offrit un aspect agréable.
Nos Sœurs Marie Célestine et Marie-lsabelle furent désignées pour cet établissement et les classes s’ouvrirent le 26 septembre. La population très accueillante leur manifesta beaucoup de sympathie. Nos Sœurs, de leur côté, s’estimèrent heureuses d’avoir à travailler au sein d’une population si chrétienne.
Trois mois après l’ouverture de l’école, sur la demande de Mr le Curé, Sœur Théophile-de-Jésus fut envoyée aux Touches. Elle fut particulièrement appréciée, tant par ses soins empressés près des malades, que par sa religieuse gaieté.
Les sœurs de Saint-Gildas restèrent aux Touches jusqu’en 1995, mais dès 1976 la direction fut confiée à un directeur laïc.
Il appartient à d’autres d’écrire la suite de cette histoire. Nous ne pouvons que souhaiter bonne route au Sacré-Cœur, et lui donner rendez- vous pour son Bicentenaire en 2040 !
| Date | Évènements | Classes |
|---|---|---|
| 1961-1962 | École des filles (près de l’église) et école des garçons (route de Nantes) indépendantes l’une de l’autre | École des garçons : une classe CP-CE1 une classe CE2-CM1-CM2 École des filles : une classe mixte MS-GS une classe CP une classe CE1-CE2 une classe CM1-CM2 |
| Début des années 70 | Les écoles ont géminé (on a mélangé les filles et les garçons à tout les niveaux) | une classe MS-GS une classe CP une classe CE1 une classe CE2-CM1 une classe CM2 |
| 1976-1977 | Une seconde maternelle s’est ouverte | une classe PS-MS une classe MS-GS une classe CP une classe CE1 une classe CE2-CM1 une classe CM2 |
| 1983-1984 | Ouverture d’une septième classe. Une classe s’installe à la mairie | une classe PS-MS une classe MS-GS une classe CP une classe CE1 une classe CE2 une classe CM1 une classe CM2 |
| 1984-1985 | Répartition de l’école sur trois sites : 1 - rue des Charmilles (près de l’église) 2 - rue du sacré Cœur (route de Nantes) 3 - Mont Juillet |
1 - rue des Charmilles une classe PS une classe CE1 une classe CE2 2 - rue du sacré Cœur une classe CM1 une classe CM2 3 - Mont Juillet une classe MS une classe GS une classe CP |
| 1989-1990 | Les deux directions ne font plus qu’une | 1 - rue des Charmilles une classe PS une classe CE1 une classe CE2 2 - rue du sacré Cœur une classe CM1 une classe CM2 3 - Mont Juillet une classe MS une classe GS une classe CP |
| 1990-1991 | Fermeture d’une classe maternelle | il y a alors 7 classes |
| 1993-1994 | Fermeture d’une classe primaire L’école est revenue sur deux sites : rue des Charmilles et Mont Juillet |
il y a alors 6 classes |
| 1998-1999 | Fermeture d’une autre classe Il ne reste qu’un seul site, rue des Charmilles |
il y a alors 5 classes |
| 1999-2000 | 5 classes réparties ainsi | une classe PS-MS une classe MS-GS une classe CP-CE1 une classe CE2-CM1 une classe CE2-CM2 |
La Maison de Retraite Saint-Joseph
La Maison de Retraite Saint-Joseph
Geste très généreux de la famille Pichelin en faveur des habitants de Les Touches : Vente pour un prix modeste à la "Société civile de l’Hospice des Touches", du Corps de Garde comprenant les bâtiments et terrains d’une superficie d’environ 206 ares, soit 20.600 m°, au prix de 50.000 francs en 1936, soit environ 35.900 euros en 2014.
Toutefois, il est expressément convenu que la Société acquéreur devra assurer gratuitement à Mlle Louise Carudel, soit dans l’immeuble qu’elle occupe présentement, soit dans toute autre partie des bâtiments compris dans la présente vente, un logement analogue à celui dont elle jouit, et ce, jusqu’au jour de son décès.

- Le vicaire général Thibaud a béni les nouveaux bâtiments de la Maison de Retraite - Ouest-France 16 juin 1961 - 1/2

- Le vicaire général Thibaud a béni les nouveaux bâtiments de la Maison de Retraite - Ouest-France 16 juin 1961 - 2/2

- Artisans et ouvriers ayant participés aux travaux des nouveaux bâtiments de la maison de retraite Saint-Joseph
Inauguration des nouveaux bâtiments en juin 1961 :

- A partir de la droite : M. Brouillard Inspecteur de la Population, M. Baron Maire et le Colonel de Maquillé
Clémence Pichelin
Clémence Pichelin
En 1840, Clémence Pichelin fait construire une maison qui sera l’école des filles, sur un terrain appartenant aux Pichelin au Nord de l’église, en face le Corps de Garde.
Clémence Pichelin légua en 1872 à la "Fabrique de la paroisse Les Touches" ce terrain avec la maison et ses dépendances. Le 19 février 1874, le conseil municipal a été d’avis unanime d’accepter cette libéralité.
L’école était administrée par des religieuses jusqu’en 1976. Mlle Lhomer Augustine, en religion sœur Ste Aimée, arrivée aux Touches en décembre 1870, âgée de plus de 80 ans, est retournée dans sa Communauté vers 1930, après avoir enseignée pendant 60 ans à l’école privée des filles.
Information complémentaire sur l’histoire de l’école du Sacré-Cœur
Clémence Pichelin née le 13 février 1812, célibataire elle vivait le plus souvent aux Touches, seul lieu du monde où elle se plut, c’était une joie pour les Pichelin d’aller aux Touches voir tante Clémence, qui était adorée des Touchois. En 1840, Clémence a fait construire l’école des fille , appelée l’école du Sacré Cœur, tenue par des religieuses les Tertiaires du Carmel d’Avranches-Coutances, et en à fait don à la Paroisse par testament le 30 octobre 1872.
Le 2 juillet 1852 au décès de sa mère Luce Pichelin veuve de Jean-Marie Pichelin maire de Les Touches de 1815 à 1830, Clémence eut le "Corps de Garde" et ses dépendances, les fermes de la Cohue, de la Censive, de la Chapelle, plus le vignoble du champ Rouge (c’était des vignes qui s’étendaient du Sacré Cœur route de Nantes au moulin des Buttes).
Clémence, son œuvre accomplie, est décédée le 22 décembre 1872.Après la Loi de 1905, l’école était tenue par des sœurs sécularisées, on appelle ainsi les sœurs qui ont été contraintes de renoncer officiellement à leurs vœux pour avoir l’autorisation d’enseigner, puis de 1932 à 1986 par les sœurs de Saint-Gildas.
Au moment de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l’Église et de l’État, celui-ci aurait voulu récupérer l’école et ses dépendances. Un procès aurait-eu lieu entre l’Évêché soutenu par la famille Pichelin, qui comptait alors plusieurs avocats, et l’État.
Contacté en février 2008, sœur Annick, archiviste de Saint-Gildas, a confirmé que le 26 septembre 1932 les sœurs Célestine et Isabelle sont arrivées aux Touches et que l’école appartenait à Paul Pichelin, elle a précisé qu’après 1905, il a été fréquent que des écoles libres soient attribuées à des prête-noms pour éviter leur transfert à l’État.C’est ce qui a dû se produire ici, d’autant plus facilement que le testament de Clémence prévoyait ce retour à ses héritiers, si sa volonté n’était pas respectée, ce qui était le cas avec la Loi de 1905. Ce "tour de passe passe" a dû rester très discret et connu des seuls initiés... pour que l’État ne perde pas la face et que l’Évêché ne soit pas pris à contre-pied pour cette "substitution" faite par les avocats Pichelin.
Paul Pichelin héritier des biens de son père Pierre Pichelin dit "Pitre"’, qui avait eu les biens de sa sœur Clémence, a cédé le "Corps de Garde" et ses dépendances pour un modeste prix, à la Société civile de l’Hospice des Touches, et transmit l’école du Sacré Cœur à la Paroisse selon le souhait de Clémence.
Sources : Jean Thiébaut Historien de la famille Pichelin, Henri Lepage octobre 2019.
Jean-Baptiste Trimoreau Prêtre non assermenté
Jean-Baptiste Trimoreau Prêtre non assermenté
SUR
DEUX PRETRES PREUX ET EDIFIANTS
M. Jean-Baptiste TRIMOREAU
1738-1794
M. Josepn-Nicocas-François TRIMOREAU
1763-1842
LA CHAPELLE-MONTLIGEON
IMPRIMERIE-LIBRAIRIE DE NOTRE-DAME DE MONTLIGEON
1908
M. l’abbé Jean-Baptiste TRIMOREAU
BÉNÉFICIER A LA BRUFFIÈRE (BRETAGNE)
M. L’ABBÉ J.-B. TRIMOREAU
Le 25° jour de novembre de l’an de grâce 1737, était célébré avec grande solennité dans l’église paroissiale de la Bruffière, au diocèse de Nantes, le mariage de N. H. Jean-Baptiste Trimoreau, sieur de la Bonnœuvre, procureur-greffier de la baronnie de la Muce en Petit-Mars sur la rivière d’Erdre et autres juridictions y annexées, au dit diocèse. Il était un des fils, et probablement l’ainé, de feu Claude Trimoreau vivant notaire royal à Nort-sur-l’Erdre et de damoiselle Élisabeth Pichelin.
Sa fiancée était une parente, damoiselle Marie-Rose Bousseau, fille de M. François Bousseau, notaire et procureur de la vicomté de Tiflauges, et de damoiselle Marguerite Martin.
La dispense de deux bans avait autorisé une seule publication aussi bien dans l’église de la paroisse des Touches, résidence du fiancé, qu’au prône de l’église de la Brufière, où demeurait la future épouse. On dut aussi obtenir une dispense spéciale au sujet du troisième degré de consanguinité existant entre les parties.
Messire Demezalve, recteur de la Bruffière, célébra lui-mème la pieuse cérémonie et bénit les nouveaux époux, assistés du père et de la mère de la future et de nombreux parents. On relève sur le registre paroissial, dans l’acte descriptif de la gracieuse solennité, les signatures de M. Julien Trimoreau, sieur des Collinières, frère de l’époux, de M. Mathurin Martin, proche parent des conjoints, et encore celles de Charles Martin et de Marie-Anne Hasard.
Nous venons de parler d’une dispense de consanguinité, exigée pour ce mariage. En effet, il n’était pas le premier contracté entre membres des deux familles. Une précédente alliance avait eu lieu entre Claude Trimoreau et Élisabeth Pichelin, père et mère de Jean-Baptiste, de Julien, de Jacques-Claude-Marie et de Anne Trimoreau. Il faut croire qu’elle avait été amenée au commencement du siècle par les
rapprochements journaliers que nécessitaient les fonctions remplies par les membres des deux familles. Car, Luc Pichelin, père d’Élisabeth, la future épouse du notaire royal Claude Trimorean, était sénéchal de la baronnie de la Muce.
Mais tout fait présumer qu’il devint ensuite, par raison de convenance, sénéchal de la baronnie de Clisson, sa femme, Élisabeth de Massalve, en étant originaire, si bien qu’on ne trouve aucune mention du décès des deux époux sur les registres de la paroisse des Touches où ils ont habité, et qu’il est naturel d’admettre qu’ils allèrent finir leurs jours à Clisson ; où Élisabeth avait ses propriétés.
Nous dirons, quand il sera temps, que la même particularilé s’attache à la mémoire des Trimoreau, dont le nom ne parait plus sur les registres de la paroisse des Touches. Ils y avaient pourtant leur bien de famille, du chef d’Élisabeth Pichelin, leur mère, et c’est un hasard exceptionnel quil m’ait été donné de pouvoir retrouver leurs tracés, ou, pour mieux dire, la terre où reposent leurs cendres. ;
Quoi qu’il en soit, des actes nombreux subsistent encore et constatent l’union et même l’intimité parfaite qui présidaient aux relations des deux familles. La naissance que nous avons à signaler le démontrera tout de suite avec pleine évidence. En effet, la nuit du 2 au 3 octobre 1738 vit naitre au bourg des Touches, résidence de Jean-Baptiste Trimoreau, le procureur-greffier de la Muce, un enfant très ardemment désiré ; on peut souligner sans hésitation ces derniers mots : il y avait douze mois à peine que Jean-Baptiste et Marie-Rose étaient mariés ; cet enfant était un fils, la première bénédiction accordée au jeune foyer et le complément de son bonheur. Pour obéir fidèlement aux sages prescriptions ecclésiastiques, on ne met point de retard à le porter à l’église de la paroisse. Dès le jour même de sa naissance, il réçoit le saint baptème et a l’honneur d’avoir pour parrain son oncle maternel, propre frère de son aïeule, N. H. Messire Céleste Pichelin, propriétaire aux Touches, procureur au présidial de Nantes et avocat à la Cour du Parlement de Bretagne ; sa marraine fut Damoiselle Anne Trimoreau, tante paternelle. Le sacrement précieux qui nous purifie de la tache originelle et nous fait enfants de
Dieu, frères de Notre-Seigneur Jésus-Christ, fut conféré au nouveau-né par un prêtre du nom de Cosson ; il ne se prévaut dans l’acte qu’il a souscrit de la qualité ni de curé ni de vicaire. Il a pu remplacer fortuitement ceux-ci en cas d’absence ou d’empèchement, comme il a pu avec leur autorisation administrer le saint baptème en qualité de très intime ami ou de parent des familles. L’extrait du registre des naissances et baptèmes de la paroisse des Touches, daté du 25 février 1897, que je dois à la complaisance de M. le Curé actuel, est authentiqué par sa signature. Il est trop précieux pour que je néglige d’en consigner le texte quelque part, dans le cours ou à la suite de ce récit. En attendant je dois dire que ce même extrait est muni des signatures du père, du parrain et de la marraine, ainsi que de la signature d’un abbé Trimoreau, sous-diacre ; nous avons toule raison d’admettre que ce dernier n’est autre que Jacques-Claudé-Marie Trimoreau, frère du greflier et le plus jeune fils du notaire royal.
Ayant de passer outre, considérons un instant les personnages figurant dans la touchante cérémonie ; ils prennent sans aucun doute les uns et les autres des engagements sérieux de direction et de protection à l’égard du nouveau-né. Par affection comme par devoir, ils seront toujours disposés à les tenir avec une scrupuleuse fidélité, sans songer aucunement toutefois à se préoccuper pour le moment de ce que l’avenir incertain pourra susciter d’imprévu et de menaçant. On rève naturellement de joie et de félicité puisque l’horizon présente tant de sérénité, et il n’y a pas que les plus intéressés à se gaudir ; la bonne population du village ne reste pas étrangère à l’allégresse de ceux qui représentent si dignement le seigneur du lieu, dont ils sont les officiers et les influents mandataires. Aussi la bourgade est-elle en liesse. Les cloches, prodiguant leurs joyeux carillons, ont électrisé la foule. Ne sait-on pas que le noble parrain, sans parler de ses mérites personnels et. de ses hautes fonctions, compte dans ses ascendants un sénéchal de la baronnie ? De son côté, le père de l’enfant, par sa charge, a loute action sur les nombreux sujets qui relèvent du beau domaine, lequel s’étend au moins à quatre paroisses. Le baptème, l’heureuse nativité du premier enfant du procureur-greflier de la Muce, est donc inévitablement un jour empreint de salisfaction et de réjouissance, qui marquera dans les souvenirs de la localité.
Serait-il contraire à la réalité d’admettre aussi qu’on ne se borne pas à participer à la commune allégresse, mais que le précieux enfant est le sujet d’entretiens fabuleux et dé présages dont les aruspices ne discordent en aucuns points ?
De porte en porte du hameau champêtre on colporte les impressions les plus favorables ; il n’y à pas le moindre doute, la plus légère dissonance ; tous tiennent le même langage, tous répètent unanimement que le petit mortel sera un privilégié entre un grand nombre. On en préjuge de la sorte par les belles qualités que l’on prête aux parents et aux grands-parents : « Bon sang ne saurait faillir ni déroger. » Quels beaux exemples n’aura-t-il pas constamment sous les yeux ! Quelles leçons de choses, comme on parle aujourd’hui, ne recevra-t-il pas en un pareil milieu et qui le porteront doucement dans les bons sentiers de l’honnêteté et de la vertu !
Une particularité rare et significative de cette naissance tant louangée n’échappa pas au bon public des Touches.
Elle aurait été du reste remarquée et interprétée partout ailleurs. Coïncidence singulièrement exceptionnelle, l’acte du baptème du bienheureux enfant précise qu’il naquit « à minuit ». Oui, il a eu ce trait de ressemblance avec le divin enfant, notre doux Rédempteur, qui daigna lui aussi naître au milieu de la nuit, mais avec des signes caractéristiques d’austérité que nous ne trouvons pas ici sous les blanches et floconneuses tentures du petit berceau du chérubin que le ciel vient de donner à la terre. Oh ! non, ce n’est pas une indigénte couchette de paille abritée d’un auvent banal où se rélugient les pauvres animaux surpris par l’orage dans les vagues pâtures d’Orient. Tout respire plutôt les attentions et les suffisantes délicatesses dans les prévenances minutieusés dont le petit chrétien est l’objet. N’importe, l’analogie est très restreinte, puisqu’elle ne porte que sur un seul point.
La confiance absolue persiste quand même. L’astre qui plane sur ce berceau ne peut être qu’un astre de bon augure, tout à fait bienfaisant, Arrière les appréhensions ! Encore une fois, toutes les opinions se concertent el rivalisent pour attribuer au jeune mortel régénéré par l’eau sainte une part enviable de félicité. Que craindre à son sujet ? Il grandira dans la sécurité et une honnête aisance ; plus tard, les charges lucratives, la confiance du Seigneur, l’estime et le respect du public viendront à sa rencontre. Il trouvera sa place sans effort dans les fonctions héréditaires de ses pères, qui, ayant fait le bonheur de ceux-ci, lui offriront le même tracé à suivre pour arriver à un but non moins salisfaisant. Ainsi se reproduit dans le village des Touches la scène biblique que l’évangéliste saint Luc rapporte de la coutume des montagues de la Judée, lorsqu’à la naissance de Jean-Baptiste, le fils du prêtre juif Zacharie et d’Élisabeth, sa femme, les parents et amis de leur voisinage se demandaient mutuellement : « Qu’en pensez-vous, que sera donc un tel enfant ? »
Et l’horoscope était unanimement heureux.
Hélas ! ami lecteur, nous ne contredirons pas à tant d’espoir autorisé, aux plus satisfaisants pronostics ; nous les acceptons de tout cœur et sans réserve par anticipation.
Fasse le ciel que les vues providentielles concordent pleinement avec la prescience et les visées humaines ! Rien, du moins jusqu’à présent, ne nous détourne d’applaudir à un enthousiasme si général et si justifié, ni de féliciter surtout l’enfant du précieux patronage qu’il trouve dans son berceau.
Quelle chance pour lui, en effet, il le comprendra un jour, de pouvoir, quand il aura grandi, s’appuyer sur un protécteur tel que Céleste Pichelin ! Et : pour ses parents eux-mêmes, quel encouragement d’avoir le droit de se prévaloir de plusieurs alliances avec une aussi considérable famille, anoblie par de délicates fonctions, et ayant gagné l’estime et la confiance depuis des générations !
Rien n’est plus facile que de remonter des fils aux pères jusqu’au début au moins du siècle précédent : Jean Pichelin ne mourut qu’en 1701, tout à la fois notaire et procureur fiscal de la dite baronnie de la Muce. Lue, son fils, le remplaça dans ces mêmes charges, que dis-je ? devint sénéchal, ayant la consolante satisfaction, à l’heure suprême, de voir ceux qu’il laisse pour continuer l’honneur de son nom, ses trois fils : Céleste, Julien et Jean-Baptiste Pichelin, tous également dignes de leur auteur, tous les trois diplômés en jurisprudence et admis à plaider au Parlement. Leurs diplômes sont encore entre les mains de leur descendant direct, conservés par lui comme de chères reliques, pour être transmis à des enfants et petits-enfants, qui ne seront certes jamais tentés de déroger à un si noble passé. Je veux parler de M. Pierre Pichelin, vénérable et vénéré patriarche plus qu’octogénaire, près d’atteindre en quelques enjambées le nonagénariat, s’il plait à Dieu d’exaucer nos désirs les plus ardents, partagés, je le sais, par l’élite de la chrétienne population nantaise, qui le couvre de son aflectueux respect.
Cette famille, si méritante et si justement glorifiée dans le passé par ce long renom de probité constante et de haute influence, n’a-t-elle pas d’ailleurs recu une sorte de regain d’anoblissement et de lustre ineffacable au déelin du siècle dernier ? — Représentée par trois sujets, tels que ces trois jurisconsultes que nous venons de citer, pouvait-elle échapper à l’œil défiant du stupide proconsul qui terrorisait alors la noble cité bretonne ? Il n’y a done pas lieu de s’étonner que deux des trois frères Pichelin, MM. Julien et Jean-Baptiste, c’est-à-dire les deux plus jeunes ou les plus redoutés, furent précisément compris dans le nombre des 132 ou 133 notables bretons, mis à la chaine et trainés à Paris, pour procurer, par la riche fauchaison de ces 132 nobles têtes, la plus suave de ces émotions à M. le marquis de Robespierre. S’ils n’étendirent leurs nobles chefs sous le tranchant de la lame meurtrière, ils doivent en rendre grâce à la divine justice qui, lasse de tant de forfaits et prêtant l’oreille au cri puissant du sang innocent, qui demandait vengeance, fit monter à temps, par justes représailles, l’indigne proscripteur sur la machine infamante du Dr Guillotin.
Le lecteur ne me blämera pas d’avoir facilement abondé dans une louange si naturelle, qui s’imposait à la pointe de ma plume. Il comprendra qu’en la prolongeant, j’étais entraîné par la plus sincère admiration. On sait que le coup de force thermidorien n’éelata pas à temps pour préserver 40 Nantais qui succombèrent à la fatigue, aux privations, aux mauvais traitements et aux rigueurs de la détention ; 82 seulement regagnèrent leurs foyers, rendus contre toute attente à leurs amis, à leurs enfants, à leurs femmes éplorées. Leur bourreau immonde subit le supplice qu’il leur réservait, sans expier assez tant de forfaits commis de son abusive autorité durant quatre mois dans cette ville profanée, souillée, livrée à ses caprices fangeux et sanguinaires. On expliquera difficilement, pour l’excuser, comment la riche et populeuse cité, si ardente dans sa défense contre Cathelineau et Bonchamps, avait pu sitôt descendre à ce degré de découragement et de prostration, sous le fouet d’un infâme tyran et de sicaires crapuleux : « Il ne se rencontra pas une Charlotte Corday, dit un célèbre historien, pour poignarder le monstre et venger l’humanité ; pas une voix n’osa flétrir tant d’horribles exécutions. Jamais, depuis l’ère des persécutions, l’humanité n’avait été ainsi flagellée. Les prisons, devenues toutes, malgré leur nombre, d’infeets bouges, regorgeaient de gens riches et lettres. L’histoire ne pourra jamais enregistrer les noms de si nombreuses vielimes. »
« Nous ferons un cimetière de la France plutôt que de ne pas la régénérer à notre manière... s’écriait le despote dans sa rage.
On se rappelle particulièrement ce qui arriva à MM. Thoinet frères, deux négociants nantais, pères de douze enfants. Après avoir déboursé 300,000 livres, afin de procurer les vivres à leurs concitoyens menacés de famine, pendant qu’ils guerroyaient en Vendée comme de bons patriotes, ils sont déclarés suspects ; les scellés sont mis sur leur maison de commerce. On les incarcère quand ils accourent pour les faire lever ; on s’empare du contenu de leurs magasins ; 221 barriques de vin d’Anjou y sont saisies, des grains, leurs valises avec l’or qu’elles contiennent, des lettres de change, des billets et des portefeuilles remplis d’assignats.
Les maitres de ces valeurs restèrent dans les cachots et y périrent de désespoir et de maladies pestilentielles. Quelle excuse donner à pareille inertie, mélangée d’une forte dose de lâcheté, sinon cette terreur troublante et presqu’insurmontable où les tenaient les arrêtés continuels du sauvage proconsul ? Quel effet ne devait pas produire sur ces gens démoralisés, cernés nuit et jour par les traitres et les délateurs à la solde du vampire, par exemple une délibération comme celle-ci affichée à tous les carrefours :
« Incarcération de tous Les riches et de tous les gens « d’esprit, suspectés par l’opinion. Séance levée à dix heures du soir. »
Bachelier, président ; Gouin, secrétaire.
Or, l’incarcération, c’était la mort. Assurément le tribunal secret des dix à Venise était dépassé ; dans ce temps-là, une victime était désignée aux coups des exécuteurs et elle disparaissait, mais ces attentats parliels peuvent-ils se comparer à une classe totale de personnes de talent, de naissance, de fortune vouée ostensiblement à la mort ? Laissons à l’écart ees souvenirs trop lugubres pour s’y appesantir plus longuement ; qu’ils fassent place à un tableau plus riant !
C’est au lieu même de sa naissance que le petit Jean-Baptiste, car il reçut au baptème le prénom paternel, à passé ses premières années. C’est dans le calme des champs, sous les ombrages purs et ensoleillés d’une nature riche de verdure et de fleurs, qu’il a donné ses beaux sourires à sa mère et payé ainsi ses caresses et ses tendres soins. Bien mieux, ce sont probablement les belles allées et les jardins de la résidence automnale de M. Pierre Pichelin, au village des Touches, qui ont vu le petit chrétien essayer sans grande hardiesse ses pas mal affermis. Douce consolation aujourd’hui, après plus d’un siècle et demi écoulé, de songer que la demeure où passa ses premiers jours celui que nous avons lieu d’estimer comme un élu du ciel, est encore le lieu héréditaire d’un homme vertueux, ayant dans ses veines des gouttes fécondes du sang d’un pieux martyr et confesseur de sa foi et qui se montre si constamment préoccupé de donner à tous les siens les plus beaux et les plus fermes exemples de piété. Ineffable consolation de savoir que le mème logis, deux fois l’an, dans ces deux admirables jours dédiés à l’insigne amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ et à son Cœur adorable, est choisi, grâce à l’insigne piété des châtelains, pour recevoir Notre-Seigneur avec son touchant cortège qui parcourt en bénissant les allées fleuries, pénètre sous les ombreux berceaux, s’y repose avec délices, comme au milieu d’un cercle de fidèles amis, y recoit l’encens et les prières, et reprend sa marche triomphale, répandant, on le devine, sur ce bon peuple agenouillé, prosterné, qui l’escorte, toutes les meilleures efusions de sa cordiale tendresse.
Nous nous faisons parfaite idée que personne des intéressès, père, mère, grand’mère el tante et autres de la bonne parenté ne faillit au zèle et à l’empressement autour du précieux berceau. N’est-ce pas l’entrainement du cœur qui porte à concourir chacun au plus hâtif épanouissement de ces petites fleurs du ciel autant que de la terre ; à provoquer les gentillesses et les gracieux instincts ; à éveiller les premiers symptônies d’intelligence par le discernement précoce et les préférences des personnes et des objets ; à secouer la torpeur et la somnolence qui enveloppent et paralysent les efforts du jeune esprit qui se débat pour percer et jeter à quelques lueurs. Qui peut dire si cette captivité suspensive du vouloir naissant n’est pas une souffrance qui appelle le soulagement et sollicite la délivrance ? Que le cœur maternel, avec sa patience, l’exubérance et l’enthousiasme de son industrieuse tendresse, doué d’une résistance qui ne se rebute jamais et s’y reprend toujours, est bien fait pour préparer et amener l’éclosion rapide de ce germe délicat comme mis en serre chaude, sous le souffle de son haleine embaumée. Fions-nous, pour produire presqu’à la vapeur, signifiant par cette locution le peu de temps qu’elle y met : fions-nous, dis-je, au cœur d’une tendre mère, d’une mère chrétienne, pour produire, dans un laps de temps très court, le résultat le plus merveilleux. Les deux émancipations sont presque simultanées ; l’une ne retarde guère sur l’autre.
La substance active par essence soulève et anime la substance passive, lesquelles rivalisent d’ardeur à rejeter leurs langes surannés, maintenant sans objet. On juge bientôt que les excitations maternelles, à force d’être répétées, et les enfantines mañœuvres des indications et des signes, qui heurtent aux yeux comme aux principales portes de l’âme, qui s’infiltrent jusqu’au délicat et flexible cerveau par les pores et les effluves de la sensibilité, ne restent pas stériles, mais accusent un progrès grandissant. Les petits membres qui s’agitent, les petites mains qui se tendent, l’illumination des traits, l’éclair du regard, sa fixité ou sa mobilité, qui se porte vers un point ou se détourne d’un objet, tous ces précieux indices disent sûrement que le but est atteint, que les sacrifices maternels ont eu leur eflicacité, leur pleine efficacité. Quelle joie, quelle satisfaction ! Il faut plaindre les mères qui ne soupconnent ni ces devoirs ni ces jouissances ; qui n’en comprennent pas la nécessité et la portée. Louons grandement, au contraire, celles qui se dévouent à leur tâche, nes’effrayent point de sa sévérité et de son étendue, s’appliquent à la remplir avec un cœur que la tendresse et la piété inspirent, voulant que leur enfant s’épanouisse entre leurs mains, uon autrement que la fleur, chauffée et choyée, qui ouvre sa fraiche corolle et exhale son premier parfum. Pour cela, qu’une mère le soit doublement : ayant donné la vie, qu’elle s’adonne aussitôt à la cultiver et à l’enrichir, qu’elle lui prodigue sa tendresse infatigable et toute la suayité du plus pur dévouement.
Ainsi fut veillé, soigné, entouré et élevé, le cher Jean-Baptiste. La piété qui régnait à ce foyer modèle en donne la certitude. Enfant prédestiné, enfant de bénédiction, aux mœurs douces, aux instincts les plus heureux, il répondit de jour en jour et d’heure en heure aux soins continus dont il fut l’objet. Quand la jeune plante, surveillée et entretenue comme nous venons de l’exposer, eut donné ses fleurs et premiers fruits sous l’œil ravi de ceux qui l’aimaient, y compris sans conteste M. le greflier de la Sénéchaussée, la tâche augmenta et devint assez sérieuse pour réclamer des auxiliaires.
N’est-il pas constant que la conscience du petit enfant est formée par les doux et tendres enseignements d’une pieuse mère ou d’une sainte tante vouée au célibat, auxquelles le cher ange est confié par la divine Providence ? Parmi les dires diffus, incohérents, mais si candides et si naïfs du jeune âge, qui ne sait rien décider de lui seul, dont les épanchements ou les questions ne tarissent jamais, c’est la mère ou la bonne tante ou l’honnèête et dévouée institutrice, tenant leur place légitime, qui agit sur l’esprit et le cœur enfantins, qui façonne et développe de son mieux, selon son habileté et ses aptitudes, cette petite âme qui s’ouvre de jour en jour, s’épanouit comme le bouton vermeil d’une rose ou le calice laiteux du lis éclatant de blancheur, et y déverse tout ce qu’elle possède de saintes convictions, d’amour pour la vérité et la vertu, les germes de foi, de bonté, d’honnêteté, qui préparent l’homme de bien et la femme estimable selon l’Évangile.
Dans cet âge susceptible dés meilleures impressions, elle prend les devants, prémunit son enfant contre le mal et le mensonge, lui inculque au plus tôt, à l’occasion, en temps opportun, les vérités d’intuition que le Seigneur dispense aux âmes de bonne volonté et que son divin Filsa commentées et confirmées de sa bouche adorable, de son infaillible témoignage. Aucun jour ne s’écoule sans qu’on raconte quelque chose de l’histoire sainte, des gestes miraculeux du céleste Jésus, le petit enfant de Bethléem, le parfait modèle, l’exemple des petits et des grands, en un mot de tous les âges. Et à l’appui, les histoires merveilleuses des jeunes saints et saintes qui, dès leur premier discernement, sont devenus des héros, des héroïnes, qui restaient fidèles aux exemples de leurs pieuses mères, s’envolaient au ciel sans crainte et sans regrets de ce qu’ils laissaient ici-bas. Quel énfant chrétien ignore la glorieuse légende des sept enfants, à qui leur mère montre le ciel et dont les têtes tombent sous le tranchant du glaive et roulent à ses pieds ? De même, la touchante histoire de sainte Agnès, qui toute jeune, elle aussi, et presqu’enfant, ne consent point à offenser Dieu et rejette obstinément les délicatesses et les grandeurs terrestres pour mériter le beau ciel qu’on lui a fait connaître et espérer ? Également, quel petit enfant n’a entendu de la bouche d’une mère le récit du jeune Symphorien, ce brave Franc de Bourgogne ? Il rencontre dans les rues d’Autun des cortèges et des spectacles qui blessent sa délicatesse et lui font horreur ; il ne peut contenir son indignation et proteste hautement contre de telles ignominies. C’est assez pour mettre les païens en fureur, qui se saisissent de lui, sans indulgence pour la fougue de la jeunesse, et le conduisent sur le champ à la mort, tandis que son héroïque mère le félicite de perdre la vie pour en gagner une méilleure.
Oh ! qu’il est done admirable le rôle d’une mère intelligente et pieuse ! Prodiguant ainsi à ses enfants tous les trésors de son esprit et de son cœur pour les former, presqu’au sortir du berceau, à être de petits anges ici-bas, afin qu’ils deviennent le reste de leur existence de fidèles disciples, des imitateurs d’un Dieu mort sur la croix pour eux ! N’est-ce pas de la sorte que procédaient à notre égard nos tendres mères, qui prenaient plus soin de nos âmes que de nos corps (et ce n’est pas peu dire), quand nous étions bien sages el mieux disposés, alors que nous nous réfugiions près d’elles pour écouter leur doux et affectueux langage, savourer leurs saintes histoires. Quand elles voulaient bien nous parler surtout du divin enfant Jésus, nous posions notre tète sur leurs genoux pour mieux solliciter leurs caresses ;
nous serions restés des heures, sans nous lasser, à les entendre, c’était un ravissement que notre pauvre langage est impuissant à redire.
Oui, je le redis en toute conviction : un père et une mère ont le devoir d’instruire et de former eux-mêmes ou par des délégués, des suppléants bien choisis, leurs chers petits enfants. Il n’y a que leur insuflisance, leur incapacité personnelle ou l’impossibilité, parce qu’ils sont empêchés soit par santé soit par les occupations, qui les en dispensent. Leur devoir ne se borne pas à les élever matériellement, à leur procurer les soins corporels, l’alimentation et l’entretien, parce que ces petits baplisés ont leur âme qui réclame de bonne heure la première culture instinetive. Sans avoir besoin d’y tant réfléchir, est-ce que la mère, qui le peut, ne s’adonne pas dès le premier moment à cette facile et récréative éducation du foyer de la famille pour apprendre à son enfant à sortir au plus tôt des langes du berceau ? L’enfant apprend à sourire en voyant la maman le faire. Les premières syllabes qu’il assemble à force de les entendre répéter : papa, maman, petit frère, petit Jésus, tante, etc ; ces premières idées qui s’éveillent par ses sens de l’ouïe, de la vue, sont les échos fidèles de ce que la patience d’une mère, d’une tante, des petits frères plus avancés, la complaisance de petits voisins, lui suggèrent, en y revenant sans fin, en se faisant un jeu de le lui répéter, de le lui faire dire.
Ces procédés bénévoles dont on s’amuse atteignent au but, à l’objectif que l’on vise, concordant avec les signes et gestes dont ils sont accompagnés pour porter son attention vers ceci ou cela. Quand le papa intervient à son tour, quand il joint ses caresses, ses baisers, les éclairs de son grave visage à ces pantomimes instruetives dont nous parlons, le petit bonhomme est encore dominé davantage. Cette voix qui semble plus impérative, qui vibre plus fortement, qui n’a pas la même douceur que celles des autres familiers du logis, le frappe, l’impressionne, fixe avec plus d’attention son inconsistant esprit, met en travail sa faible puissance pour deviner ce qu’on lui montre, pour déchiffrer ce qui est pour lui autant d’énigmes...
Qui s’occupa de l’enfant ? Qui lui dévoua des soins plus virils ? Qui lui consacra un temps proportionné au zèle, à la docilité qu’il montrait déjà pour apprendre ? Qui voulut bien le suivre, le guider, l’écouter et répondre, autant qu’il était besoin, en profitant du bon vouloir et en ménageant les forces ? La maîtresse du logis ne l’était plus autant d’elle-même. Un second fils, Julien-François, venait de naître et partageait sa vie et ses tendresses avec Jean-Baptiste. L’intervalle de ces naissances n’avait pas été long.
Le père, homme consciencieux, qui avait à cœur d’exclure l’inexactitude de l’accomplissement de ses laborieux devoirs, ne disposait que de rares moments de répit. Les intérèts du seigneur, la gestion d’un grand domaine, commandaient ; le service de la juridictiän, sous l’autorité de M. le sénéchal, commandait également ; M. le procureur fiscal, M. le greffier responsable devait agir sans négligence et obéir. Le père de famille n’avait pas les loisirs désirables pour suffire aux sollicitudes domestiques.
Est-ce cela tout simplement ? Sont-ce plutôt des considérations d’autre genre, mais non moins décisives, telles que des sollicitations des parents Bousseau, ou mème des engagements pris à ce sujet au jour des fiançailles des jeunes époux ? On ne le peut préciser à la distance où nous sommes de l’événement. Il convient d’admettre que pour des motifs très sérieux, des avantages pécuniaires ou des opportunités morales, le greflier de la baronnie de la Muce prit sa résolution peu de temps après le baptême de son second fils.
Cette concession fit sans doute le bonbeur des uns, mais déchira du mème coup le cœur des autres, dont on devait s’éloigner.
Le second héritier, portant le nom de son oncle paternel et celui de son grand-père maternel, avait reçu l’eau sainte du baptême dans l’église des Touches, avec la même exactitude, le même respect de la loi ecclésiastique, aussitôt sa naissance. Non moins bien accueilli et fêté que son aîné, également carillonné par l’airain retentissant, objet des mêmes cérémonies, des mèmes réjouissances de la parenté et de la population dévouée à la famille, fut donc inscrit Julien-Francois sur le registre, d’où l’on infert que ce fut l’oncle M° Julien Trimoreau, sieur des CoMinières, qui le tint sur les fonts baptismaux et lui communiqua son prénom en vertu de son parrainage.
Malheureusement Julien-François ne fit que paraître et disparaître. C’est quelque chose de bien fréquent, il est banal de l’observer, que ces vicissitudes, ces joies et ces tristesses qui se remplacent et portent les ämes à une défiance perpétuelle. La stabilité, la demeure permanente, appartiennent à l’autre monde. lei nous sommes des pèlerins, des voyageurs courant après une destinée plus solide et que nous ne saurions rencontrer. Voici au jeune foyer un premier deuil, bien voisin des journées sereines du début : Il y en aura une douloureuse série de semblables, qui ne promettront guère de détacher ses yeux du ciel et de compter sur les promesses trompeuses de la vie. La douleur de cette perte s’ajouta aux incertitudes et aux perplexités que ressentit le sieur de la Bonnœuvre en quittant ses fonctions et
son pays.
Ces charges, il les prisait, il s’était promis de les transmettre à l’un de ses fils. Jusqu’alors il n’avait pas eu d’autres vues, d’autres ambitions. Rompre avec un passé qui lui offrait et aux siens pleine sécurité et de grands avantages ; laisser une contrée où ils avaient leur bien de famille, où ils étaient devenus populaires et prédominants, où ils comptaient d’honorables parents, de nombreux amis, et avant tout, pour les attacher, des seigneurs puissants, bons et indulgents qu’ils avaient servis en officiers fidèles, oh ! que le greffier dut souffrir de la rupture de tant de lieus, de ces dures séparations, de ces cruels adieux, qu’on ne peut se figurer que très imparfaitement. Il est possible même que le sacrifice dépassa de beaucoup ce que nous venons d’indiquer.
s’il dut aller jusqu’à la fatale nécessité de s’éloigner de leur mère, Élisabeth Pichelin, la veuve de Claude Trimoreau, le notaire de Nort, et sœur du procureur an Présidial de Nantes, Je suis porté à croire en effet que la sucecssion de cette dame ne fut ouverte entre ses enfants qu’à une date postérieure à la migration de la jeune famille des Touches.
Enfin, si pénible qu’il fût, le sacrifice s’accomplit. La procure et le greffe de la baronnie de la Muce, aujourd’hui connue sous la dénomination de Pont-Hue, furent échangés contre d’autres fonctions de même ordre. Jean-Baptiste était trop judicieux pour modifier à ee point son existence sans être assuré de compensations tout au moins équivalentes.
Mais avant de commencer le récit de celte autre période de sa vie, pour nous permettre d’apprécier ses légitimes regrets, disons quelque chose de la valeur de ce domaine seigneurial dont il abandonne l’administration.
Pont-Hue ou la Muce était encore, à cette époque et jusqu’à la Révolution, une très ancienne et importante terre.
Le chef-lieu de la seigneurie était en Petit-Mars, sur la rive sud de l’Erdre, rivière qui complète le canal de Brest, jusqu’au déversement de celui-ci dans la Loire, au milieu de Nantes. La chaussée d’un étang reliait la demeure féodale au vieux bourg, de là le nom de Pont-Hue, qu’elle porta d’abord au moyen âge, dès le XIIe siècle, nom qu’elle a repris d’ailleurs et garde maintenant. J’en ai souvent salué avec intérêt dans mon enfance les impressionnants vestiges et débris, sans me douter de quelqu’autre dénomination. Successivement en furent possesseurs et maîtres Geoffroy de Liré, Guillaume de la Muce, le chancelier Chauvin, et en des temps plus rapprochés, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le marquis de Goyon de Marcé. Les Charette de la Contrie y ont aujourd’hui leur résidence.
Il serait long et fastidieux de s’attarder au dénombrement des propriétés qui constituaient le grand domaine de Pont-Hue. Le manoir par lui-même était gigantesque. Ses ruines en imposent encore. Une légende avait cours, prétendant que ses jours et ouvertures ne le cédaient pas au nombre des jours de l’année, C’était le vrai château-fort avec ses lours sourcilleuses, ses douves profondes, ses murailles doubles et crénelées, pont-levis, ete., etc. Par arrêt de Parlement, il fut battu en brèche et mis en ruine pour punir la félonie de son seigneur qui avait pris part au conciliabule de la Rochelle.
Le seigneur jadis avait « droits de garenne par le tout de la paroisse de Petit-Mars, nombreux bois laillis, forest forestable, gardée par forestiers, assise sur marais et eaux, jusqu’aux marais de Sucé, tenant à Révérend Père en Dieu, Monseigneur l’évèque de Nantes, qui y avait sa maison de plaisance ».
Rien ne manquait donc pour attester et garantir le haut domaine des seigneurs du lieu. Et pourtant jusqu’au XVe siècle, les seigneurs de la Muce ne furent que de simples bacheliers. C’est à Pierre II, duc de Bretagne, comte de Montfort et de Richemont, époux de la bienheureuse Françoise d’Amboise, dont S. Ém. le cardinal Richard, archevèque de Paris, a écrit l’édifiante histoire, qu’ils doivent leur élévation. Par sa charte du XII de novembre mil quatre cent cinquante cinq, il créa le chevalier Messire Guillaume de la Muce et de la Chère-Gérault, baronnet, avec droit pour lui et ses principaux héritiers de porter en avant de lui et eux, leurs armes en bannière, tenir et avoir justice patibulaire à quatre posts, et de jouir perpétuellement de tous droits et prérogatives appartenant à bannière, tout ainsi que font et ont accoutumé faire les autres bannerets du dit pays de Bretagne. Ainsi le voulons et nous plaist, et au sieur de la Muce l’avons octroyé et octroyons de grâce especial et affin que ce soit chose perpétuelle, ferme et stable, nous avons signé les présentes de notre main et fait sceller de notre grand scel à lac de soie, de cire verte ; réservé en tous endroits nos droits, etc... Signé par le Duc en son général Parlement, Lucas, et scellé de cire rouge à simple queue.
Dans le préambule de la dite charte (série E, Arch. départ., Loire-Inférieure), le duc se plait à dire que son bien amé et féal chevalier, seigneur de la Muce et ses prédécesseurs ont tenu une des plus anciennes bacheleries du pays et que ses seigneurs toujours ès fois que besoing a esté, se sont trouvés en grand et bon appareil à son service à la défense du pays et au bien de la chose publique, et qu’ils ont terres et seigneuries et revenus en grande quantité, suffisance à soutenir plus grand estat que de bachelier, et que constituez en plus haut estat, ils en serviront mieux et à plus grande puissance et pourront mieux valloir à Nous et à la chose publique de notre dit pays.
Pour permettre de mieux apprécier l’importance de la seigneurie de la Muce, autrement dite Pont-Hue, je répète que rien ne faisait défaut de ce qui peut constituer un grand domaine : terres, prairies, bois, eaux et forêts, moulins de diverses espèces, même celui du foulon. Un aveu de 1734 énumère plus de 300 boisselées et septrées. La déclaration de 1870, pour réforme des précédentes, au rapport, témoigne et par conséquent contrôle de tous les intéressés, en présence du procureur fiscal de la baronnie et annexes, M Lorette de la Refoulaye et du greffier Olivier Foucaud, porte le total à 603 cordes et 51 pieds de terre. Or, la corde, ancienne mesure agraire, répondait à notre boissolée actuelle, en usage encore dans tout le val de la Loire, et qui vaut cinq ares cinquante centiares.
Je pourrais ajouter ici que le seigneur avait droit de pèchage et l’exerçait ou l’affermait le long des rives de la charmante rivière d’Erdre, depuis la vaste nappe d’eau désignée sous le nom de plaine de Mazerolles, qui forme tous les hivers un immense bassin de plus de quatre lieues de périmètre, jusqu’à l’autre plaine de la Poupinière, si perfide par ses coups de vent imprévus et tant redoutée jadis de la nombreuse batellerie qui devait l’affronter.
La juridiction s’étendait aux trois paroisses de Petit-Mars, de Liré ot des Touches. Sa cour pouvait chacun an instituer trois hommes et sujets, pour faire ofice de receveur, de sergent el d’avenier. Ils recevaient les rentes el devoirs, chacun en sa paroisse et baillage : savoir, « le receveur : les rentes et deniers, froment de rente, poullés, oyes, moutons, rachats, saisies, deshérences, épaves et gallois et autres devoirs ».
Les sergents s’occupaient des taux, amandes, appréciements de biains et corvées.
Les aveniers étaient les mesureurs aux greniers du seigneur, sis en lieux divers. !
Le haut baron pouvait contraindre ses sujets de faire office de forestiers pour la garde des forêts, marais, eaux, bois et autres domaines et garennes, répondre des prises et tenir compte des forestaiges. Les hommes du fief sayaient, moissonnaient et fenaient pour leur seigneur, engrangeaient les bleds et les fourrages pour lui. On ne les escomptait que de leurs dépenses ; les faucheurs recevaient douze deniers, monnoie de Bretagne ; les fanneux quatre deniers et les chartiers leurs dépens seulement. Cela s’appelait Debvoirs d’ayde, lesquels subsistèrent jusqu’à la Révolution.
On s’attarderait facilement à décrire, si c’était le moment, les rives enchanteresses de la gracieuse rivière, devenue le dernier affluent du canal de Brest, à six lieues environ de son déversement dans le beau fleuve de Loire. Ces bords pittoresques, où l’œil qui s’y promène contemple sans discontinuer de vraies merveilles de grâce et de goût, réunissent certainement ce que l’art et la nature, en concertant leurs richesses, peuvent produire de fantaisies heureuses et d’inimitables caprices. On a su avec le temps, qui n’est pas étranger à ces œuvres, ménager tour à tour les points de vue les mieux réussis, les clairières et les perspectives les plus à souhait. C’est une interminable confusion de superfluités qui captivent l’attention, qui ne permettent pas à la curiosité séduite de se détourner tout le cours de la placide navigation de tableaux imprévus, de sites presque fantastiques que vous offrent les heureux mélanges de l’ombre et de la lumière.
Autrefois, dans ma jeune naïveté, avant d’avoir connu les montagnes et les horizons sans limites et les altitudes troublantes, j’étais prêt à parier que rien ne pouvait se comparer aux féeries et aux paysages de la gracieuse rivière, au trajet qu’elle offrait sur sa surface calme et limpide, aux ombrages séeulaires que le ciel diaprait de ses ors et de sa pourpre.
O vivaces réminiscences de notre jeunesse, vos charmes candides ne perdent jamais leur vertu de faire battre nos cœurs ; qu’il était délicieux ce moment où, revenant pour quelques semaines au foyer de la famille, le front ceint de quelques lauriers gagnés par de fiévreux efforts, l’écolier, triomphant offrait ce front au baiser chaleureux d’une mère... où il lui faisait hommage aussi de beaux volumes, gages bien mérités d’une application soutenue, de rares et indéfectibles labeurs. Père, mère, dans leur joie exubérante, que n’auraient-ils pas promis, que n’auraient-ils pas donné en récompense de ces succès et de leur propre satisfaction ? Mais l’écolier n’était pas exigeant, et toutefois il avait bien lé sentiment de demander une large récompense. Se penchant à l’oreille maternelle, il sollicitait tout bas un gai voyage à Nantes. À Nantes, la vraie capitale de la chère Bretagne, la grande ville aux 100,000 âmes et plus, la ville à la vieille cathédrale de Saint-Pierre avec son chef-d’œuvre le tombeau des Carmes, la cité maritime si animée en ce temps-là, qui présentait alors le spectacle unique de ses quais prolongés, remplis de grands vaisseaux venant de toutes les parties du globe, avec leur forêt si dense de pavois, de mâts, de voiles et de cordages entremélés, inextricables en apparence, qu’on ne se lassait pas de considérer, avec l’incomparable perspective de la Fosse, cette promenade la plus solennelle des avenues, côtoyant les bassins et leurs navires pressés, se prolongeant à perte de vue, entre les lignes d’ormeaux géants, qui dépassent de leurs têtes altières les hôtels et les dépôts où s’engouffrent pour tant de millions les productions coloniales,
Hé bien ! la requête timide de l’écolier avait été accueillie.
En effet, à quelques jours de la joyeuse fin d’année scolaire, par une belle matinée de fin d’août (les vacances étaient alors si retardées), on prenait le coche local au modeste attelage, et de relais en relais, on arrivait au faubourg Saint-Georges de la petite ville de Nort. On embarque, le bateau est sous pression, la cheminée fume ; oh ! un bien modeste diminutif des beaux Larochejacquelein qui desservent la Loire ! Mais il manœuvre pour prendre son élan, et nous voici voguant sur l’onde pure avec une sage et économique lenteur. Bientôt les escales se répètent, on stoppe à tout propos et complaisamment pour lout le monde ; nul besoin d’embarcadère. Le riverain, l’hôte du château, se présente à l’échelle de tribord ou de bâbord, et embarque. Ces arrêts multiples occupent, distraient et diversifient le plaisir et l’intérêt, pendant que la nef reprend sa marche et vogue de plus belle. Tout d’abord voiei Pont-Hue qui se montre avec son donjon ruineux, portant à son vieux front la majesté des ans et, hélas ! pour ceux qui savent, ses plaies béantes des bombardes. Le regard rêveur des adolescents ne quitte lé gigantesque squelette de pierres que lorsque s’est évanouie dans le lointain la fantastique apparition. Alors se succèdent sans fin d’autres féeries qui peuplent et côtoient ces silencieuses rives : elles s’étagent ici et là parmi la dense feuillée où pointent des clairières ménagées par les habiles paysagistes. Ainsi de la superbe habitation de la Gâcherie, jadis aux de Charette, aujourd’hui à la famille de Poidras.
Ainsi encore de la Desnerie aux de Sesmaisons et de cette foule de villas ou de demeures plus seigneuriales, offrant chacune les aspects les plus divers, à l’aide des mêmes éléments, modifiés dans leur agencement et leur distribution selon l’artifice mis en œuvre. Ce sont longtemps de hautes futaies qui couronnent les crêtes des pentes : ailleurs, des chènes séculaires, plongeant dans les eaux leurs racines puissantes et inelinant sur leur surface une ondoyante chevelure, ou encore, plutôt sur la rive droite des pelouses et des corheilles de toutes les nuances, la profusion de la verdure et des fleurs, dont l’évaporation matinale et la tiédeur de l’atmosphère entretiennent la fraicheur. C’est toujours le règne du silence et de la solitude, depuis la nappe argentée de Mazerolle jusqu’au chenal et an débarcadère de Barbin.
Tout est silence, en effet, et contraste avec les larges horizons de notre Loire : vastes tableaux d’une part, ici une délicieuse série de miniatures ; là, le bruit, le mouvement, le flot pressé d’arriver qui bat la rive, le courant qui clapote el gronde parfois. Les forts chalands descendent à la dérive, se croisent avec les blanches voiles déployées qui remontent avec effort ; c’est l’industrieux commerce et Je travail fécond. Ici, c’est le délassement et le charme de la vie à soi dans le plus ravissant des cadres ; le doux bonheur passager de la vie retirée ; à l’abri des tumultes comme symbole de ce calme digne d’envie, la pelouse plonge sous les eaux, les nénuphars s’étalent à leur surface ; c’est bien, encore une fois, le décor tout divin de la prière, du recucillement, de la réflexion, de la pieuse rèverie. Je voudrais le pouvoir, j’espacerais sur ces coteaux boisés et paisibles beaucoup de chapelles et d’ermitages, où revivraient les anachorètes d’antan.
Mais, débonnaire lecteur, n’est-ce pas avoir soumis votré patience à une bien longue épreuve ? N’est-il pas urgent, après tant d’écarts, de rentrer précipitlamment dans notre sujet et de ne plus en sortir ?
C’est fait, c’est accompli : alea jacta est ! Le sort en a décidé, disons mieux : la Providence l’a permis. Les adieux ont été faits au sol natal ! La maison des Touches, malgré un passé plein de souvenirs, malgré l’idylle des deux petits berceaux, symbolisant de si chers événements, est abandonnée, comme lant d’autres objets, avec un cœur qui souffre et s’immole. Elle passera, Dieu merci ! quelque jour, nous l’avons déjà laissé entendre, à des parents qui ne-sont et ne seront jamais des étrangers : Messire Céleste Pichelin, l’oncle dévoué, le parrain de Jean-Baptiste, voudra, biën en faire l’acquisition. Il rendra de grands services aux quatre enfants de sa sœur, Élisabeth Trimoreau, liquidera leurs intérèts, les dégageant de tout embarras.
C’est vers le lieu de la Bruffière, le pays natal de Rose Bousseau, épouse du greffier de la Muce, que Jean-Baptiste Trimoreau et les siens se sont dirigés. Nous n’avons pas la date précise de leur émigration, mais elle ne peut guère se reporter à plus de deux ans et demi en decà de la naissance de l’ainé des deux garçons. Cette localité assez importante, aujourd’hui encore de plus de 3,000 âmes, qu’ils adoptaient pour y aller vivre et y mourir la plupart, faisait partie alors du diocèse de Nantes et présentait l’intérêt particulier d’être pays de Marches, sur les confins extrêmes de la Bretagne et de la Vendée poitevine ; elle est maintenant du diocèse de Lucon.
J’est à Saint-Symphorien, portion de territoire, où existait dans ce lemps un prioré avec sa chapelle, où existe encore maintenant une église tréviale, annexe de la paroissiale, que se passa une première rencontre, ou, selon le langage du pays, un premier choc entre les fameux soldats des trois garnisons de Mayence, de Condé et de Valenciennes et nos Vendéens ex sabots. Ceux-ci surprirent fort ces hommes de guerre si renommés, quand ils les virent se battre aussi bien qu’eux-mêmes. Ils en ont fait l’aveu avec assez de sincérité, pour que leur étonnement ait été recueilli et consigné dans l’histoire.
C’est aussi au bourg de la Bruffière que Charette, le 4e janvier 1796, fut trahi et faillit être livré par une femme qui lui avait offert ou donné l’hospitalité. A peine put-il se réveiller et s’esquiver, peu vêtu, sans avoir le temps de prendre des papiers importants. Il venait de se battre avec avantage aux trois moulins, dans le voisinage de Montaigu ; mais Travot reçoit des renforts, le bat à son tour et le rejette sur la Bruffière, où il compte avoir une nuit de repos. Les habitants vivaient depuis un an dans un calme relatif, qui leur avait permis de relever leurs chaumières, ils ne se souciaient plus de reprendre les armes ; mème des prètres, dit-on, partageaient ces dispositions. Ce fut là que l’indomptable partisan trouva la trahison, qui fut près d’en avoir raison définitive. « Elle avait, dit Pitre Chevalier, avec son style imagé, revêtu la forme charmante de Mlle Grégo, fille de la marquise de ce nom ; confidente des chefs royalistes, cette dame s’éprend de Hoche et lui livre ses ennemis. » Il ajoute que des paysans et quelques prètres, séduits par l’or du Directoire, l’imitèrent. Deniau est aussi explicite : « On accuse, selon lui, de cette lâche trahison Mlle Grègo, correspondante habituelle des chefs royalistes, qui entretenait en mème temps des relations secrètes avec le général Hoche. »
Il dit aussi que deux ou trois prêtres, fatigués de la guerre, crurent à l’efficacité de ce moyen plus propre que tout autre pour la terminer promptement. Le poète et l’historien plus réservé se prononcent de la même manière. Plus tard, l’annexe de la Bruffière, Saint-Symphorien, nous intéressera particulièrement.
Les beaux-parents du greffier démissionnaire de la Muce existaient encore. C’est pour vivre près d’eux, pour leur plaire et complaire à sa digne femme, que M Jean-Baptiste avait consenti à son héroïque déplacement, lequel évidemment n’était pas dépourvu de compensations ni d’avantages temporels. Nous avons déjà laissé comprendre que l’ex-greffier devait échanger sa charge pour des emplois du même genre. Il n’en pouvait être autrement ; l’ex-greffier était trop nouvellement établi pour songer à renoncer au travail ; il avait le goût et les aptitudes de sa profession et il avait besoin, dans l’intérêt de sa maison, de profiter longtemps de sa jeunesse et de son savoir, M. Bousseau, pour sa part, était un homme trop sérieux et de trop bon jugement pour songer à soutirer son gendre et le porter à se démettre de fonctions lucratives, avant d’avoir plus qu’une équivalence à lui offrir. La maxime si sage de ne pas quitter la proie pour l’ombre, le certain pour l’incertain, était bien la devise de l’un comme de l’autre. Beau-père et gendre ne pensaient pas différemment. Une situation au moins égale, en apparence supérieure même, attendait donc indubitablement le jeune et prévoyant père de famille. Les circonstances des convenances séduisantes l’avaient sollicité et le dédommageraient sûrement du passé regrellé et des gros sacrifices subis.
N. H. Jean-Baptiste Trimoreau, sieur de la Bonnœuvre, fils aîné du notaire royal, devenait de simple greffier procureur, procureur fiscal et notaire de la baronnie de Montfaucon en Anjou, nouveau terrain ou théâtre où il allait exercer son talent juridique et prouver à de nouveaux maitres et seigneurs le mème dévoûment. La position serait-elle meilleure pécunièrement ? Très probablement. Ce fut sans doute la grande excuse qu’il dut présenter à ses anciens maîtres et les prier d’agréer plutôt que de motiver sa rètraite par le simple désir d’être agréable à la parenté de sa femme. De même, ce fut cette forte raison qui porta la famille si recommandable de sa mère à ne pas se plaindre de la pénible séparation. Loin, en effet, d’en montrer de l’humeur, l’oncle dévoué, Messire Céleste Pichelin, le procureur au Présidial, se fit le complaisant acquéreur de propriétés qui n’étaient plus à la convenance de ses neveux, puisqu’ils quittaient le pays. MM. Trimoreau, ses trois neveux Claude, Julien et Jean-Baptiste, par une série d’actes de cessions conservés aux Touches dans les papiers de la famille Pichelin, firent abandon de leurs propriétés. Dans un aveu rendu au seigneur, Messire de Goyon de Marcé, pour les terres relevant du fief de la baronnie de la Muce, les trois frères déclaraient que ces biens provenaient tant des successions de leurs père, mère, tante, frères et sœurs, que de contrats d’acquêts de Claude-Marie, Jean-Baptiste et Julien Trimoreau, leurs neveux. Et ces cessions furent closes en l’année 1754, le 14e jour de juillet, par un dernier acte où l’abbé Jacques-Claude-Marie Trimoreau , l’ex-sous-diacre, signataire au baptème de Jean-Baptiste, le premier de ses neveux, se déclare et signe vicaire et prêtre de chœur de la collégiale de Saint-Pierre d’Ancenis ; vendant également et définitivement à ce même oncle Céleste, l’avocat au Parlement de Bretagne, « tout ce qui pouvait lui compéter dans la paroisse des Touches à lui échu de la succession de feue Demoiselle Élisabeth Pichelin, sa mère ».
C’en était fait : l’existence de la famille que des alliances avec la famille Pichelin avaient attirée aux Touches et aux environs peut-être sur le fief de la baronnie, ne serait plus qu’un souvenir qui ne tarderait pas à s’effacer. J’observerai ici d’ailleurs que l’acte de mariage de Claude Trimoreau, le notaire royal de Nort, et d’Élisabeth Pichelin, spécifiait que les bannies avaient ëté faites tant à Saint-Pierre d’Ancenis que dans l’église paroissiale des Touches. Ce mariage, qui remonte à la date lointaine du 22 avril 1709, permettrait donc de supposer que les parents de Claude, le notaire royal de Nort, ou l’un des deux au moins, soit Pierre Trimoreau, soit Jeanne Guillot, sa femme, fussent originaires d’Ancenis. Ce monde n’est plein que de contrastes el d’antithèses criantes : ils ne règnent pas que dans les choses, ils apparaissent tout autant dans les sentiments, et les incidents quelconques les font éclater. Ici, je veux dire dans la nouvelle patrie des émigrés, on est dans la joie, on est tout au bonheur de revoir les chers exilés où considérés comme tels ; là-bas, dans les lieux d’où l’on vient, on a laissé bien des regrets, on a laissé soi-même une large part de son âme. Ceux qui ont vu les autres partir sans laisser aucune fiche de consolation, sans nul espoir de retour, ne peuvent oublier les absents ni se faire à une séparation si peu attendue. Il faut attendre que ces trop vives impressions s’émoussent, que le temps, le grand consolateur, fasse soi œuvre et, ramenant chacun à la saine raison, atténue les regrets, sèche les larmes, rétablisse le calme et la paix.
Page 73
L’ABBÉ J.-B. TRINOREAU
Cher abbé ! Il se fit, lui aussi, des illusions décevantes. Il crut d’abord que ces violences et abus de justice de la première heure ne persisteraient pas. Il vit fermer les églises et se persuada qu’on les rouvrirait bientôt. Il vit traquer les prêtres, puis les riches, les bourgeois, les suspects.
C’était trop fou, trop extrème pour durer. Il était bon, mais d’une rare bénignité, d’une modération et d’un calme exceptionnels ; les réponses à ses juges le démontreront tout à l’heure. Il était ingénu, candide, comme son patron et modèle saint Symphorien. Il n’avait sondé que le fond de son propre cœur et y assimilait celui des autres qu’il ne croyait pas capable de contenir tant de mauvais venin de haine et-de scélératesse. Voilà pourquoi il s’obstina, tout en prenant des précautions contre les délateurs, à rester caché dans quelques refuges secrets de son cher pays ; on peut même ajouter qu’il le fit au-delà de ce que le voulait la prudence. On pourrait peut-être faire valoir quelques excusessur ce point.
Si, en effet, le pieux abbé s’était démis de son prieuré, n’ayant plus charge d’âmes, il est possible qu’il ne füt-pas d’abord recherché et inquiété, n’étant pas censé fonctionnaire, selon la prétention arbitraire du pouvoir ; il rentrait dans la catégorie des simples et honnêtes citoyens. Et la logique aussi bien que la loi du moment auraient voulu qu’on le considérât comme entièrement dégagé de l’obligation du serment sehismatique. Mais la loi finit par ne plus admettre d’exception et la logique était devenue, à cette date d’eflervescenee insensée, le moindre des soucis de ceux qui auraient dû y tenir, emportés qu’ils étaient par la seule idée de pouvoir tout ce qu’ils prétendaient.
Admettons d’ailleurs aussi que M. l’abbé Trimoreau, l’ancien vicaire et chapelain, commit facilement un autre crime aux yeux des proscripteurs, celui de ne s’être pas désintéressé jusqu’au suprème moment de rendre des services quelconques à ses anciens paroissiens. De là est venue et s’est maintenue la tradition locale qui veut, qu’à l’heure où la Vendée vaincue fut réduite, pour se dérober à l’enmemi, à franchir notre superbe fleuve afin de ralentir le fougue des poursuites, l’abbé Jean-Baptiste Trimoreau fut obligé ; de son côté, de prendre la fuite. Voici le récit légendaire qui, sans contredire M. l’abbé Grégoire, peut très bien s’harmoniser avec le narré des chroniques paroissiales : Il était à l’autel, célébrant dans son ancienne église de Saint-Symphorien, entouré d’un petit nombre de pieux fidèles, lorsqu’on signala le danger. Il achève à la hâte le saint sacrifice, dépouille rapidement les vêtements sacrés et fuit de toutes ses jambes en compagnie de quelques personnes qui purent l’imiter. Bien lui en prit. La colonne incendiaire, partie de Montaigu pour se porter sur Tiffauges et Cholet, arrivait, mettait tout à feu ét à sang. Elle venait d’opérer un affreux massacre dans un champ de genèts voisin, quand elle déboucha à Saint-Symphorien. Un instant après, tout brûlait à sa suite ; hameau, église, prieuré étaient la proie d’un monstrueux incendie.
M. l’abbé Trimoreau nous apprendra lui-même la direction qu’il avait prise dans la nécessité où il fut de sauver sa vie. C’est ainsi que se forma l’opinion qu’il avait passé la Loire avec les troupes vendéennes et qu’il avait trouvé la mort dans la glorieuse mais désastreuse expédition.
La vérité historique est tout autre. Il profita du passage de l’armée pour franchir le fleuve dans ses rangs et comme l’un des siens ; mais il se sépara d’elle, quand elle quitta elle-même sa première étape, c’est-à-dire à Candé, pour continuer son aventureux exode. Il crut mieux faire sans doute, lui étranger à la province d’Anjou, en se réfugiant momentanément et isolément dans une contrée religieuse, hospitalière au clergé, peu distante de son pays (ses amours, toujours) qu’il se flattait de regagner au plus tôt. Il nous fera bientôt connaître qu’il mena, six longs mois d’hiver, une vie errante et menacée. Il dut fréquemment changer d’asile, afin de ne pas compromettre les honnêtes gens qui l’hébergeaïent pour l’amour de Dieu. Dans la condition imprévue où il avait opéré son départ de La Bruffière ou de Saint-Symphorien, on préjuge assez facilement qu’il n’avait pas emporté sur lui grand viatique. Plus de six mois durant, ce prètre, fils de bonne maison, vécut donc constamment de charité et sous un travestissement minable, avec une santé probablement très altérée, ayant le chagrin et l’inquiétude de se voir, dans cet état, à la merci de toutes les surprises.
Bientôt, en effet, il se hasarda malheureusement à changer de refuge. Il va, sans guide devant lui, en un pays qu’il n’a pas fréquenté, comme un pauvre égaré, sous l’œil de Dieu qu’il invoque avec un filial abandon. Quel état, selon l’exclamation oratoire de Bossuet, et quel état ! oui, quelle différence avec sa situation passée, avec sa condition d’autrefois ! L’infortuné ne va pas loin. Il traversait une vaste lande de la contrée, où elles n’étaient certes pas rares, qui porte le nom de Lande du Moulin-Blance, sise entre Challain-la-Poterie et le village du Tremblay. Un peu plus tard, un autre prètre du même nom aura l’occasion de célébrer le saint sacrifice au milieu de cette lande devant un rassemblement de 3,000 fidèles. Il traversait donc cette lande lorsqu’il fait la rencontre d’une patrouille, qui le reconnait pour un prètre et l’arrête. Conduit aussitôt à Segré, emprisonné, il comparait devant le magistrat instructeur qui dresse mandat d’arrêt, l’interroge avec la plus fallacieuse rigueur, puis, ayant réuni contre le doux prévenu une somme de conclusions défavorables, l’envoie du cachot du district à la maison de justice d’Angers, pour être déféré sans délai devant les juges du tribunal criminel du département de Maine-et-Loire.
Vous prendrez connaissance, cher lecteur, de la longue procédure, que je n’ai pas voulu insérer dans la trame de mon humble récit, mais renvoyer in extenso parmi les quelques pièces dont je me suis servi. Vous serez certainement édifié des sentiments que le saint prêtre fit paraître en cette solennelle circonstance où sa vie était en question, de la candeur, de la sincérité de ses réponses. Il serait difficile, je crois, de faire briller davantage le calme, la dignité, et la sérénité d’une âme sacerdotale qui sait bannir toute crainte, et se confie au Seigneur qu’elle a servi et aimé dignement et cordialement. C’est bien le disciple attentif à la leçon du Maitre : Quand vous aurez à paraître devant les magistrats, ne dissimulez rien, parlez ouvertement, avec franchise, ne cherchez même pas ce que vous aurez à dire ; l’Esprit de votre Père parlera par votre bouche et vous suggérera le langage à tenir. C’est l’homme épris à ce point de la vérité qu’il préfère se trahir par un excès de sincérité plutôt que de recourir aux réticences qui la diminueraient ou la déguiseraient. Mais le malheur voulut qu’il eût affaire à des juges peu sensibles à cette touchante candeur. Dieu ne nous a pas permis de voir s’ils oseraient appliquer la loi, toute la loi.
L’abbé Jean-Baptiste Trimoreau n’avait prêté aucun serment. Au lieu de se soumettre à la loi de déportation, il l’avait bravée en restant sur le territoire de la République.
Quand on lui demande pourquoi il n’a pas prêté le serment exigé indistinetement de tous les ecclésiastiques : Je ne l’ai pas jugé à propos, et en plus je ne l’ai pas voulu, répond-il, on lui observe en outre qu’il a accompagné, un certain temps, une troupe armée de rebelles, et qu’il l’a avoué, sans qu’on le lui demande ; il s’est condamné lui-même, il ne s’excuse ni ne rétracte rien. Le juge aurait pu lui dire : Mais je pourrais vous juger sur votre aveu, ex ore tuo te judico.
Enfin il reconnait aussi que c’est la crainte de perdre sa liberté, qui l’a détourné de répondre aux exigences du Directoire de la Vendée et de se rendre au chef-lieu départemental, dans la maison où l’on réclusionnait les prêtres. Je retiens le mot prèt à couler de ma plume, j’allais dire le pare des malheureux prêtres, où on les entassait sans pitié, sur une litière peuplée des plus répugnants insectes. Si les prêtres vendéens partagent le traitement des ecclésiastiques nantais et vendéens, ces derniers ne recevaïent aueun objet de literie. Aux yeux de ses juges ou du moins du sieur Simon, l’accusateur public du tribunal criminel, si l’on s’en réfère à son réquisitoire aussi bien qu’à l’insidieux interrogatoire du juge instructeur Bobot, il reste démontré que l’ancien bénéficier de La Bruffière est un grand et parfait coupable, à qui rien ne manque pour mériter de porter sa tête sur l’échafaud ou du moins d’être embarqué sans délai pour la côte ouest d’Afrique, selon le texte même, entre le vingt-troisième et le vingt-huitième degré sud.
C’est cette alternative qui plana un mois durant environ au-dessus de la tête de la victime détenue dans les prisons de Segré ; elle se représenta avec un poids plus accablant et une menace plus immédiate sous les voûtes sombres et humides de la maison de détention d’Angers et du cachot de la maison de justice, antichambre habituelle de la guillotine. L’infortunée victime, épuisée de longue main par les privations d’une existence aussi incertaine, d’une durée de onze ou douze mois plutôt que de six mois, en proie à tant d’alarmes, soumise à des affres, comme celles de l’échafaud ou de l’exil perpétuel, semble absolument résignée à tout.
Elle est muette, Dans la pièce officielle que nous possédons, ne se trouve pas la plus légère observation de sa part. C’était le lendemain 28 brumaire qu’il aurait comparu devant les juges suprèmes. — Dieu intervint à temps et l’en dispensa, en lui donnant pour prix de ses œuvres, de ses souffrances et de son héroïque fidélité, nous le croyons fermement d’après la promesse divine, sa place en Paradis.
Celui, a dit le Sauveur, qui n’aura pas rougi de moi devant les hommes, me trouvera pour répondre de lui devant mon Père. Dieu n’exigea pas, (il avait, paraît-il, accompli toute justice) Dieu n’exigea pas, pour le récompenser, qu’il passät entre les mains de l’exécuteur des jugements criminels. Ses juges, je ne veux pas dire ses bourreaux, furent dispensés de verser le sang du juste. Cette opportune intervention de la main divine leur évita le contre-coup d’un remords.
Au revers du dernier feuillet du dossier du prétendu criminel, de l’insoumis aux lois, on lit : « Procédure de Jean « Trimoreau, prétre non assermenté, détenu dans les prisons de Segré. » Puis un peu au dessous et d’écriture différente : « Décéde en la prison nationale, 10 heures du soir »
L’éloge du saint prêtre est contenu dans ces quelques lignes ; il est court, mais complet : prêtre non assermenté, c’est-à-dire prêtre catholique, ferme dans sa foi, fidèle à son Dieu et à la sainte Église de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Décédé à la prison nationale, c’est-à-dire mort pour sa foi, martyr et victime de ses saintes convictions, fidèle jusqu’à la mort au devoir du prètre... Quoi de mieux pour obtenir sans délai la miséricorde totale du souverain Juge ?
Pour mon compte, depuis que je sais que cette prison dite palionale, démolie et remplacée par la large rue de Saint-Étienne, a été le dernier théâtre de la lutte du saint confesseur ici-bas, la dernière station de la voie douloureuse suivie par l’estimable prêtre, quand je passe dans cette rue qui porte un nom prédestiné, celui du martyr lapidé qui rendit le premier témoignage de son sang à Jésus, je suis tenté de m’agenouiller et de baiser ce sol foulé par un autre confesseur de sa foi, mourant dans l’abandon d’une froide nuit d’octobre et daus les transes de l’agonie pour son maitre Jésus. Quelle peinture serait faisable pour reproduire la vraie figure de cet agonisant sous les verroux de son glacial cachot, épanchant à Dieu, à la douce Vierge Marie, qui seuls peuvent l’entendre, les mortelles tristesses de son äme ! Oh ! je le pense, n’ayant pas de consolateur parmi les hommes qui le délaissent et le menacent, Dieu (gui consolatur nos in omni tribulatione nostra) aura daigné secourir son prêtre, cet autre Christ, sacerdos alter Christus, et lui ménager quelque vision céleste, réconfortante, Un ange aura remplacé les barbares humains et rafraichi le juste dans ses süprèmes efforts, le spasme, la convulsion finale pour exhaler son âme. Il aura emprunté les traits d’une mère adorée clamant à son oreille le eri de la mère de saint Symphorien : « Courage, cher fils, tu vas me rejoindre, Jésus l’appelle, « Jésus l’attend. »
Ainsi finit à Angers, dans la prison voisine du Quartier des Halles, le 28 brumaire, an HI de la République, une et indivisible, dans sa cinquante-sixième année, Jean-Baptiste Trimoreau, prêtre du diocèse de Nantes, fils de N. H. Jean-Baptiste Trimoreau, sieur de La Bonnœuvre, greflier, procureur de la baronnie de La Muce, puis procureur et notaire de la baronnie de Mautfaucon-sur-Moine et de Marie-Rose Bousseau, fille de M° Bousseau, notaire et procureur de la seigneurie de Tiflauges.
Ce dénouement dramatique couronnait admirablement une vie de modestie et de piété, Cette triste mais noble fin semble s’être inspirée des souvenirs de Gethsémani et de ceux du Golgotha, témoins des défections et des délaissements que l’on sait. Ils répéteront toujours les échos de la grande voix : « Les disciples ne sont pas au-dessus de leur maitre, ils ne seront pas mieux traités. Ils boiront, ainsi que lui l’a fait d’abord, le mystique calice des amers mélanges : Je leur ai donné l’exemple pour qu’ils le suivent, sans se rebuter ; exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ila et vos faciatis. »
M l’abbé Joseph-Nicolas-François TRIMOREAU
CURE DE LA PAROISSE DE NOELLET (EN ANJOU)
15 avril 1768 — 2 octobre 1842
La suite ne concerne plus Les Touches, la famille Trimoreau ayant quitté Les Touches en 1754, après avoir cédé ses biens à la famille Pichelin.
Inauguration de la Place Clémence Pichelin le samedi 25 mai 2019
Pour naviguer dans le portfolio, vous pouvez
- cliquer sur les flèches gauche/droite à gauche et à droite de l’image en mode zoom
- utiliser les flèches gauche/droite du clavier
- passer le portfolio en mode diaporama automatique en cliquant sur "Diaporama" au dessus de l’image en mode zoom
Notes
[1] Clémence
 | Se connecter
|
Plan du site |
| Se connecter
|
Plan du site |