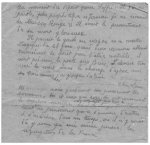Mémoires d’un maquisard : Edmond Jaunasse alias "Soulanges", maquisard présent au Maquis de la Maison Rouge et au Maquis de Saffré
mardi 28 juin 2022 , par , ,
Edmond est né le 6 novembre 1909 et décédé en 1956.
Il a travaillé à la ferme avec son père et son frère et un peu en Mairie.
Nommé par la Préfecture comme Syndic pour la répartition des bons alimentaires pendant l’occupation.
Memoires d’Edmond Jaunasse alias "Soulanges"
Dans la première quinzaine de Janvier 1944, nous eûmes une réunion importante : un nouvel officier venait nous rendre visite. Il s’appelait "Jean-François" et remplaçait Briac parti ailleurs se cacher. Il faisait d’ailleurs partie du groupe d’officiers venus en Octobre 1943 avec le colonel Fantassin "Lecourbe".
Je montais au grenier, où l’officier était à causer avec Mme Jamonneau et Yannick. Il parait que ce "Jean-François" était ancien officier aviateur, bel homme, l’air très maître de lui, figure sévère. Je me présentais, il me reçut aimablement. Nous descendîmes et nous allâmes causer dans le chemin en haut de la prairie. Il m’expliqua le but de la Résistance.
J’abordais la question de la succession de Claude. Je dis que seul, Louis me paraissait apte à succéder à Claude dont il avait toute la confiance et que d’ailleurs, il exerçait les fonctions depuis le départ de Claude.
Ce fut Louis qui fit la présentation du groupe. "Jean-François" passa la revue, avec son regard froid et dur. Le fanion, au bout d’une baïonnette au fusil, était tenu par l’un des nôtres, après que le "repos" eût été prononcé, l’officier se mit à causer avec nous. "Jean-François" nous présenta notre nouveau chef à qui il demanda de prendre un nom. Louis proposa de s’appeler "Loulou". "Jean-François" dit que ce n’était pas le nom d’un chef. Louis choisit "Marceau". Passant sur le sujet des armes, il nous dit que nous en aurions si nous étions dignes. En attendant, il demandait deux volontaires pour aller chercher ces armes dans un département voisin. Personne ne répondit mot. Cette indolence le mit en colère : "Comment ? Pas un volontaire pour aller chercher ces armes, vous n’avez pas honte !" Personne ne répondait, une sensation de malaise planait sur l’assistance. Enfin Jean Etienne se déclara volontaire avec un autre, je ne me souviens plus qui. "Jean-François" redevint plus doux et déclara qu’il n’avait voulu que nous éprouver, que les armes nous seraient apportées. Il s’efforça de détruire le malaise de cette réunion.
Quelques jours après le 10 Janvier - c’est noté sur mon agenda -, j’allais à Nort à un rendez-vous avec Mr. Aoustin, curé de Carquefou, qui allait à Héric. Je l’accompagnais jusqu’au canal. Je lui racontais notre réunion et la demande de volontaires pour aller chercher les armes. Vous avez bien fait de refuser, me dit-il. Vous n’avez qu’à dire : "Quand il s’agira de chasser les Boches, nous en serons, mais d’ici là, nous ne voulons pas nous exposer."
Un soir, nous recevons l’ordre de nous rendre à la Maison Rouge. Des armes sont arrivées : 3 mitraillettes et un révolver. Pierre Martin est allé en chercher une partie à Ancenis. Il les ramène dans une valise, à bicyclette. Yannick a apporté le reste. Malgré mon indécision, je m’y rendis avec les autres. L’officier n’était pas à l’heure. Il arriva avec une heure de retard : il s’était égaré, et était allé demandé son chemin chez nous, Alphonse l’avait renseigné. Georges était son nom, tout jeune, l’air très doux, le contraire de "Jean-François". L’instruction commença après que des sentinelles eussent été posées à tous les chemins aboutissant à la ferme. Nous avions été partagés en trois équipes devant recevoir l’instruction pendant une heure chacune. Je faisais partie de la première. Nous nous exerçâmes à monter et démonter les 3 mitraillettes que nous avions et à garnir les chargeurs de balles. Cela ne nous semblait pas bien difficile.
Soudain, sans nous prévenir, Georges, qui visait la porte ouest du cellier, se mit à tirer par coups et par rafales. Il essaya aussi le révolver, qui s’enraya. Louis et Marcel, qui gardaient le chemin qui mène au château de la Pécaudière, accoururent dire que le bruit se faisait entendre très loin. Cela n’eut pas l’air de toucher beaucoup le jeune officier. Néanmoins, nous décidâmes de suspendre la séance. Je demandais à Alph. si l’on avait entendu quelque chose au village : sa réponse fut négative. Il est vrai qu’au moment des détonations, la plupart des gens étaient enfermés dans leur maison en train de souper. Le lendemain, nous apprîmes que les détonations avaient été entendues de plusieurs. Dans la matinée, les gendarmes descendirent à la Maison Rouge disant que quelqu’un, passant sur la grande route, avait entendu des détonations semblant partir de la Maison Rouge et en avait porté la nouvelle à la gendarmerie. La fermière, Léontine, déclara que ces détonations avaient sans doute été produites par la moto du vétérinaire venu voir une jument malade à la ferme. Les gendarmes se contentèrent de cette réponse. Ils étaient allés auparavant à Chaudron où Pierre Hardy avait entendu la pétarade. Les gendarmes, il est vrai, étaient au courant de l’existence du groupe, notamment Pédron.
Sitôt midi, comme c’était dimanche, je me rendis à la ferme pour décider encore une fois de mon sort. Je m’expliquais avec Georges, en présence de Louis et de Pierre Rialland venus aux ordres. Je dis que j’étais près à me retirer du groupe si l’on ne me trouvait pas utile. Georges me demanda de rester, disant que je pourrais rendre service, tout en ne combattant pas, et qu’en me retirant, ce serait d’un bien mauvais effet pour les autres. Je m’en allais jusqu’à Joué, l’après-midi avec Pierre Rialland et François Bourré. Le soir, je devais être encore de la première équipe pour l’instruction, mais au moment de partir, j’eus des visites. Je fis prévenir que je ne pourrais aller que plus tard. Comme je montais la route, avec Dinand je crois, nous rencontrâmes Albert, les Etienne, Joseph Retière, Roger Maisonneuve, qui revenaient : les instructions étaient supprimées. On craignait qu’à la suite des coups de feu, les Allemands n’aient été alertés et viennent cerner la ferme. Tristement, nous revînmes au village. Albert me souffla à l’oreille que les armes étaient cachées dans un fossé, au bas de notre vigne, et qu’il nous fallait les enterrer par prudence, nous cherchâmes des boîtes de bois où furent enfermées les armes et les munitions. Nous allâmes les enterrer dans notre champs de choux des Monnières. Il faisait un clair de lune superbe. Nous étions quatre : Albert, Dinand, Joseph Retière et moi. Nous plaisantions en travaillant, mais au fond, nous avions bien peur des suites de la maladresse de Georges que nous revîmes à la Duchetais, chez les Bourré où il venait coucher par mesure de précaution. Je crois que Pierre Martin ne dormit gère tranquille cette nuit-là.
Il était question de deux nouveaux groupes fondés récemment, l’un à Fay-de-Bretagne, l’autre à Bouvron, groupes dirigés par les vicaires de ces paroisses. Le 10 Février, je partis, de grand matin, à Fay, à bicyclette, au clair de lune, jusqu’au canal. L’air était très froid et le vent soufflait avec assez de violence contre moi. Mon nez se mit à couler, m’obligeant à me moucher très souvent. A Héric, j’achetais des allumettes croyant être obligé de faire du feu pour me réchauffer. Je n’engageais sur la route de Fay. J’y passais pour la première fois. Enfin, j’arrivais à Fay de bonne heure dans la matinée. Au milieu du bourg, je rencontrais un prêtre en carriole. Je l’arrêtais pour lui demander le presbytère. Je lui demandais s’il ne serait pas le vicaire. Sur sa réponse affirmative, je lui dis que je venais de la part de Georges pour m’entretenir avec lui de la Résistance. Il me demanda d’aller l’attendre à la cure. Il allait chercher un bidon de lait dans un village pour faire des gâteaux pour l’approvisionnement du buffet, à l’occasion d’une pièce théâtrale devant avoir lieu le dimanche suivant. Je mangeais, en l’attendant, un morceau que j’apportais, à la cuisine, puis, je m’en fus visiter le bourg, l’église, je pris un café dans un Café pour me réchauffer. Quand l’abbé Fleury rentra, je l’aidais à dételer la vieille jument aveugle, puis, il m’emmena dans sa chambre où nous causâmes une bonne heure. Je lui exposais mes scrupules, sur la responsabilité que je prenais en encourageant par ma présence et par mes conseils, les jeunes gens à entrer dans la Résistance, d’autant plus que le Comité de la Libération groupait pas mal d’hommes adversaires de la religion et de l’ordre. Il me répondit qu’il avait eu les mêmes scrupules et qu’il était allé à Rougé voir l’abbé Riochet qui l’avait engagé à se lancer sans hésiter dans la voie de la Résistance. Il avait organisé à Fay un groupe bien vivant. Son collègue de Bouvron travaillait lui aussi avec la même réussite. Les grandes qualités que me paraissait avoir l’abbé ne pouvaient manquer d’entrainer les bons cœurs de la chrétienne paroisse de Fay. Je dus prendre un verre de vin blanc avant de partir et je me remis en route. Il faisait toujours aussi froid, et, à partir d’Héric, le vent s’étant tourné vers l’est, je me retrouvais l’avoir dans le nez comme à l’aller. L’état de mon nez ne s’était point amélioré, il coulait de plus belle, si bien que je rentrais à midi, épuisé. A Nort, j’appris la mort subite du comte Le Gualès, maire de Joué et, en rentrant à la maison, celle d’André Couteau, jeune homme que j’avais envie de demander pour notre groupe.
Certes, le voyage de Fay nous avait encouragé à continuer dans la voie où nous étions engagés. Chaque fois que nous nous rencontrions entre membres du groupe, nous ne causions que résistance, armes, coups de main possibles. Je fus souffrant plusieurs semaines : une crise de sinusite s’était déclarés à la suit de ma tournée de Fay. Ceci m’empêcha de retourner à St-Mars-du-Désert. Et malgré tout, je n’osais, c’est sans doute là une grande faiblesse de ma part, prendre la responsabilité de la fondation d’un groupe à St-Mars où, avec un peu d’encouragement, la chose marchait toute seule.
D’après les accords passés entre l’Allemagne et Vichy, les gars des classes 40 et 41 devaient partir accomplir une période de service de travail en Allemagne.
Certes, nos jeunes n’avaient point envie de partir, loin de là !
Mais ils se demandaient comment éviter le départ. Je leur prêchais la révolte. Les Allemands, se faisant accompagner des maires, allaient chercher les jeunes à domicile et, en cas d’absence, prenaient les parents, ce moyen étant radical. Je dis aux jeunes que je ne voyais qu’un moyen de ne pas partir : la révolte ouverte. En Juin 43, au moment de l’appel de la classe 42, j’avais commencé ma campagne contre la déportation. J’étais décidé à tout faire pour empêcher les appelés de partir, mais, je me demandais avec inquiétude ce qui se ferait ailleurs. Étant allé à une réunion à Nort présidée par le sous-préfet, concernant le ravitaillement, Monsieur Bardoul nous prit à part et dit ces quelques mots : "Que les jeunes se cachent et n’aillent pas en Allemagne !" Je m’en revins transporté, et immédiatement, je dis à deux gars de la classe : "Dites à vos camarades : qu’aucun ne parte en Allemagne. Cachez-vous. C’est un ordre que je vous transmets. Ne dites pas que c’est moi qui vous le donne". Le lendemain, tous vinrent me voir, je n’en étais pas plus rassuré.
Me basant sur ce qui s’était passé à Ligné où les Allemands, arrivés de nuit, s’en allaient chez tous les réfractaires, les arrêtaient ou prenaient leur père ou leur mère en cas d’absence, tout un quartier de la commune s’était sauvé dans les champs. Des réfractaires avaient ainsi échappé aux raffleurs.
Bientôt, le bruit couru que les jeunes gens indispensables à l’exploitation des fermes où ils se trouvaient pourraient être affectés pour le Service du Travail dans les dites fermes. Pour cela, il fallait que les demandes soient transmises par les maires et syndics.
Dans cette intentions, nous demandâmes audience, le maire et moi, au lieutenant du district de Nort, chargé des affaires agricoles. Il nous reçut le 10 mars, fort aimablement. Il ne causait pas le français, mais avait un interprète alsacien se disant ancien officier français. Il fut entendu que je mènerais ces messieurs dans les fermes employant des réfractaires, qu’ils examineraient les cas et trancheraient. Nous prîmes rendez-vous pour le jeudi 16 au matin à la Marchanderie, chez la femme de J. Guillet qui pour ce jour-là employait Henri Pichot. Tous les réfractaires n’avaient pas d’emplois valables, mais tous, ne voulant pas partir en Allemagne, s’étaient débrouillés à trouver place chez des femmes de prisonniers de préférence. Le 15, ils vinrent tous me voir, et j’eus à établir et à signer des certificats dont le modèle avait été établi par M. Dugué, adjoint à Nort. Comme l’officier s’était inquiété où il pourrait manger, je passais la consigne aux gars : "Débrouillez-vous, leur dis-je, pour nous offrir à boire, à manger et du tabac."
Le jeudi matin, je me rendis à la Marchanderie où ces messieurs arrivèrent peu après. Marie Guillet appela son pseudo-domestique, qui fut affecté à son exploitation "sous ma responsabilité", me fit remarquer l’interprète, ce qui ne me flatta pas trop.
- 2ème maison : la Noë Rouge, chez Félix Leray qui demandait de conserver son vrai pour lui. Mutilé de la Guerre 14-18, il boitait, ce jour-là, à patte cassée. Tout alla bien. Nous bûmes un coup de vin blanc.
- 3ème maison : chez Marie Ertière, de Carcouet, femme de prisonnier. Il s’agissait de lui affecter son voisin, Jules Nerrière. Ce dernier tremblait comme la feuille. Des saucisses, apportées par Jules Nerrière de chez lui, étaient accrochées à la cheminée. "Saucisses, saucisses !" s’exclama le lieutenant. La fermière lui offrit d’en faire cuire, ce qui le remplit d’aise. Il en mangea deux avec beaucoup de sauce et très peu de pain. Jules offrit un paquet de cigarettes qui fut le bienvenu. A partir de là, je rançonnais tous les affectés pour un paquet ! Ce troisième fût affecté comme les précédents.
En passant chez nous, nous nous arrêtâmes. Je présentais ma famille. Nous bûmes une bouteille de baco. Déjà, le lieutenant me traitait familièrement, m’appelant "grand filou". Il nous montra une vue de sa villa, c’était un gros propriétaire exploitant.
Nous arrivâmes à la Maison Rouge. Pierre Martin et Louis étaient devant la maison. Des poches de Louis, sortaient des tracts, des revues de collaboration. Nous déjeunâmes et mes deux antagonistes burent passablement. Pour finir, l’on nous servit du Cointreau très fort qui nous étourdit tellement que ces messieurs refusèrent d’aller plus loin pour ce jour là. Ils affectèrent Louis à la ferme d’autant plus facilement que les autres domestiques, Maurice et Paulette, étaient dans les champs pendant notre présence à la ferme. Je m’en allais jusqu’à la Simonerie, chez Monsieur Bouju, qui avait invité le lieutenant à venir goûter son muscadet. Je me demandais comment ces pauvres fritz allaient se rendre à Nort : ils sortirent de chez M. Bouju, pleins. En les quittant, je leur donnais rendez-vous chez Mme Rio, la voisine de M. Bouju, pour le lendemain à 8h. Je dus faire savoir à Alexandre Robert de revenir le lendemain à sa soi-disante condition (?) et fis dire au véritable valet de disparaître. Tout alla bien, là encore : nous bûmes vin, café.
- 2ème maison : la Chère, chez le père Dugué : 3 fils prisonniers. Il s’agissait d’affecter Jules Ferrand, des Mazures, là, nous demandons une omelette : affaire conclue.
- 3ème maison : chez Forget, à la Bellangeraie, affectons A.Ouairy, de la Rigaudière, buvons vins de baissière (?).
Ensuite, direction la Réauté, je crève au Tertre, nous repartons à pied, nous affectons Bte Bourré, fils unique pour ce jour-là !, à la ferme de son père infirme. Invités à manger, nous remercions, voulant allez jusqu’au Bois-Geffray. Cependant, avisant un saladier plein de boursette, le lieutenant veut en manger, seul, il en mange une assiettée, il mange sa salade comme une vache, boit plusieurs verres de noha, en compagnie de son digne interprète. Et en route pour le Bois-Geffray, chez François Derennes, mutilé de guerre, manchot : il s’agit d’affecter H. Bourré. L’affaire s’arrange très bien. Nous craignions des difficultés, la ferme étant petite. Mais, l’aînée des filles, Marie, a disparue, le père et la mère sont considérés comme incapables de travailler, tous les deux, Gisèle est jeune, et pour grossir le cheptel, Henri Bourré a amené les deux bœufs de son père, du reste, nous n’allons pas à l’étable. Nous déjeunons copieusement. La mère Derennes donne un coin de beurre à l’interprète, c’est un chineur : à la Réauté où nous arrêtons à reprendre mon vélo que j’avais laissé à réparer à Bte Bourré, il demande un litre de vin à emporter. Ils promettent d’ailleurs de revenir voir tous ces braves gens qui les ont si bien reçus, projet qui ne me laisse pas sans inquiétude : il y a tant eu de fourberies qu’il est bien difficile qu’ils ne s’en aperçoivent pas... s’ils reviennent. Nous prenons la route du bourg, allons aux Mazures, chez Ménard, où nous affectons Alph. Dauvé, c’est la seule maison où nous n’acceptons rien, à part la cigarette. Le dernier affecté est Louis Tessier, de la Cohue, là, pas de fraude, personne n’est caché, mais le père est vieux, et puis, on boit du bon vin blanc, l’interprète en chipe encore un litre à emporter.
Enfin, je suis content. Au début, on ne voulait m’affecter que quelques jeunes gens, et tous y sont. Nous finissons la journée chez le maire, où nous dégustons du muscadet. L’interprète en chipe encore deux bouteilles. Et nous nous quittons en nous jurant éternelle amitié. Ils ne sont pas plus saouls que la veille.
Nous ne nous faisions pas d’illusion sur la valeur des contrats, mais cela faisait toujours gagner du temps.
A quelques temps de là, le lieutenant fut changé. Nous eussions été satisfaits s’il avait emmené l’interprète, mais il restait. Il nous fallait faire une visite de remerciement pour imiter les gars de Nort. De plus, je devais remettre plusieurs paquets de cigarettes, de jeunes affectés qui n’en avaient pas donnés lors de notre passage. De plus, on avait promis un papier de garantie aux affectés. Je m’en allais donc revoir la boîte allemande située près du pont de St-Georges, à Nort. J’emmenais Louis, Henri et Jules Nerrière. Nous fûmes reçus par le nouveau lieutenant, beaucoup plus exubérant que son prédécesseur et assez sympathique à première vue. Nous les régalâmes au bistrot, car, malgré la recommandation de l’interprète, nous n’avions pas apporté de litres. Nous nous séparâmes dans les meilleurs termes. Je devais avoir l’occasion de revoir le lieutenant Lorentz plusieurs fois, et être dans les meilleurs termes avec lui jusqu’à l’affaire du maquis.
Nous savions qu’il existait un autre groupe de Résistance dans la commune, plus discret, moins nombreux que le nôtre, qu’il comptait parmi ses affiliés : Louis Fougère, la maison Pierre Marchand, du Meix, et même le boulanger, Félix Foucaud, chargé, disait-on, du ravitaillement, dont l’animateur était, nous nous en doutions, Cadiou, "commandant Joseph". J’avais connu ce Cadiou au cours de l’hiver 40-41, lorsque je travaillais à la mairie, lui étant marié à l’institutrice. Il m’arrivait souvent de le rencontrer. C’était un homme poli, mais froid et distant. Il avait été, dit-on, candidat député communiste. Bientôt poursuivi par la police vichyssoise, il avait été compromis dans un vol important opéré au château de Lucinière, au profit de la cause. Il se cacha longtemps chez P. Marchand où il faillit bien être pris un jour.
Voir : Francs-tireurs et Partisans
A la suite d’imprudences de Louis, Louis Fougères, très fin observateur, avait éventé notre groupe. Il réussit à être à peu près au courant de nos faits et gestes, et lui-même finit par causer de son groupe, d’abord avec Louis et Pierre Martin, plus tard, avec moi.
J’eus l’intention de demander Maurice Lepage pour notre groupe, étant à travailler avec son père et ses frères dans le village. Je le pris à part et lui demandais s’il n’aimerait travailler au salut de la Patrie en entrant dans la Résistance. Il me dit qu’il faisait partie d’un groupe, lui et son père et plusieurs autres jeunes du bourg qu’il me nomma bien que je ne lui demandais aucun détail, et que, de mon côté, je ne dis rien et ne nommais personne. Le lendemain soir, son père vint me trouver et me dit qu’il appartenait à l’Armée Secrète (A.S.), qu’il était chef pour Les Touches et que son chef était Félix Boudet, de Nort, et le chef au-dessus était le malheureux Letertre, de Châteaubriant, qui venait d’être arrêté par les Allemands. Pour moi, je ne dis rien de plus. Je convins seulement avec lui que nous garderions le secret de nos entretiens. Je n’avais rien dit de compromettant, lui, avait été moins sobre que moi. Il devait dire quelques mois plus tard, dans une maison du village, qu’un groupe de résistance existait dans le quartier. Je me félicitais de n’avoir cité aucun nom. Louis commit une maladresse, en allant leur reprocher leur indiscrétion, il se faisait connaître ainsi à eux.
Voir : Armée Secrète (A.S.)
Un jour, il vint une lettre à la Maison-Rouge, signée "Patrice-Yannick". C’était bien l’écriture de Yannick avec des phrases d’espoir et de menaces à l’adresse des Boches. Elle avait été mise à la poste à Ancenis. J’expliquais à Louis, quand je vis la lettre, que c’était là une grande maladresse de la part d’un homme qui paraissait aussi prudent que Yannick, qu’il aurait pu n’écrire que pour annoncer son arrivée. Il vint à la Maison-Rouge la semaine suivante.
A la suite de l’affaire Hupin de Riaillé, un membre d’un groupe de résistance FN, nommé M..., s’était fait arrêter, avec un camarade, probablement par imprudence. Il eut la maladresse de mettre en cause quelques gars de Joué, qui pourtant n’avait pris aucune part à l’action. Sur dénonciation sans doute, la Gestapo s’en fut arrêter Pierre Rialland, à la ferme de ses parents, bien qu’il fut très tard. Heureusement, ce soir-là, personne n’était couché à la ferme. Les hommes étaient encore occupés à soigner les bêtes dans les étables, lorsqu’ils entendirent un coup de feu. C’était les policiers qui arrivaient à la ferme. Le chien les aboyant furieusement, l’un d’eux lui tira une balle de révolver, qui ne l’atteignit pas, mais qui donna l’alarme à la ferme. Au bruit de la détonation, Pierre s’esquiva dans les champs. Brutalement, les policiers rassemblèrent les habitants de la ferme et demandèrent où était Pierre. Les parents, avec beaucoup de sang-froid, répondirent qu’il était en Allemagne, et montrèrent à l’appui une lettre de Pierre envoyée de Paris, lorsqu’on l’emmenait de la prison de Bordeaux en Allemagne. Pressé de questions par les policiers,, M... disait toujours que c’étaient bien la ferme et les parents de Rialland.
- "Tu as vu mon fils ici ?", lui demanda le Père.
- "Non", répondit le prévenu
- "Alors, ce peut bien être un autre Rialland".
La ferme fut fouillée. Puis, ils décidèrent d’emmener le père. Puis, ils allèrent directement arrêter deux jeunes résistants au bourg de Jouée, nommé Trogé et Malherbe. Les deux jeunes hommes, qui attendaient un stock d’essence, cette nuit-là, à la vue de l’auto, s’avancèrent. Ils furent aussitôt entourés et durent monter en voiture. Ils arrêtèrent aussi un cousin de Malherbe, domestique chez Louis Fougère, qui, cette nuit-là, se trouvait à Joué. De là, ils décidèrent d’aller au Plessis arrêter un nommé Derouet et dénoncé par M... lui aussi. Ils se consultèrent, le chauffeur déclarant que d’autres devaient y passer cette nuit-là. Le père Rialland crut comprendre qu’ils parlaient de la Maison-Rouge. Le chauffeur déclara qu’il n’aurait pas assez d’essence et qu’il ne pourrait tout mettre dans la voiture.
- "Il n’y a qu’à relâcher le vieux", dit l’un deux. L’auto devait être du côté des Auberdières.
- "Avez-vous loin à vous en aller ?", lui demanda-t-ton.
- "Non, quatre kilomètres"
- "Allez-vous-en".
L’on pense si le père Rialland ne se le fit pas dire deux fois ! Il s’en revint en hâte. Quel soulagement ce fut pour toute la famille, et surtout pour Pierre, qui était rentré. Le père raconta la tournée et qu’il avait cru comprendre que la Maison-Rouge était visée. Il voulait lui-même aller prévenir.
- "Reste", lui dit son fils, "tu ne trouverais pas la ferme. Je vais y aller moi-même".
Et, il y vint par les chemins détournés, à travers champs, jusqu’à la Maison-Rouge. Prudemment, il approcha et réveilla Louis, lui racontant ce qui s’était passé chez lui. Ils jugèrent qu’il fallait prévenir les gars de Nort. Louis partit de suite à bicyclette. Il alla chez Nauleau d’abord, près de la gare, mais il eut beau appeler, frapper à la porte à coups de sabots, personne ne bougea. Alors, Louis partit chez Roger, qui habitait près du pont de chemin de fer sur la route, et, sans doute, afin d’être entendu, il s’annonça bruyamment, car Roger peu satisfait lui demanda s’il voulait réveiller tout le quartier. A l’annonce du danger, il ne s’émut pas davatage. Enfin, il dit qu’il allait prévenir ses amis.
Les policiers n’arrêtèrent pas Derouet au Plessis, qui, au bruit de l’auto, s’esquiva. L’auto repartit en direction de Riaillé, avec les prisonniers. Ils ramassèrent sur la route des voyageurs attardés, coupables de n’être pas chez eux après l’heure du couvre-feu. Ne pouvant monter tous les délinquants, ils arrêtaient, flanquaient une volée aux pauvres types, et la voiture repartait. Le lendemain, ces derniers furent relâchés ainsi que le valet de Louis Fougère, tandis que Trogé et Malherbe étaient transférés à Nantes. Ils devaient y rester jusqu’à la Libération et s’engager ensuite dans les FFI.
Louis était entré en relation avec Yacco, alias Briac. Il alla une fois ou deux, le voir à N.D. des Landes. Il vit plusieurs types de la Résistance, dont un laitier qui lui remit une livre de beurre pour envoyer à Claude. Ce laitier était "Mazarin", le bras droit de Yacco. Ordre nous fut donné de nous tenir prêts à partir au premier ordre venu. Nous aurions deux heures pour nous apprêter. Une auto viendrait nous prendre. Nous ne devions pas rester dans la région, comme nous le pensions, mais probablement aller appuyer un débarquement nouveau quelque part. Cela nous fit réfléchir. Cette perspective de sacrifice ne nous réjouit guère et, après quelques jours de réflexion, nous fîmes dire à Yacco que nous ne partirions pas, que l’on nous avait promis que nous devions rester dans la région : nous voulions y rester.
Nous étions en relation avec les gars de St. Philbert de Grand-Lieu. Un des membres du groupe, pris à la suite d’une imprudence, dénonça tout le groupe. Une partie avait été arrêtée, l’autre était dispersée. Quelques-uns devaient venir chercher asile chez nous. Nous les attendons tous les jours. Pierre Hervé et Paul Orieux, les deux que nous connaissions, arrivèrent un jour. Louis nous prévint. Je me rendis à la Maison-Rouge, le midi. Ils voulaient à tout prix retourner à Nantes chercher des armes cachées, mais Pierre Hervé, chef de groupe, avait une apparence suspecte. Je proposais de les habiller en soutane. Je les amenais chez nous. Je demandais à nos réfugiées, Mme Olivier, des soutanes de l’abbé, leur fils et petit-fils. Elles firent quelques difficultés, craignant d’attirer des ennuis à celui-ci. Je leur dis que je prenais tout sous ma responsabilité. Elles y consentirent. Nous habillâmes Pierre Hervé qui faisait un charmant ecclésiastique. Nous renonçâmes à habiller Paul Orieux, trop gros pour se mettre dans la soutane !!! Je l’habillais dans mon complet gris. Ils partirent et revinrent sans encombre, ramenant deux camarades : Maurice Orieux, frère de Paul et un autre gars. Tant de monde passait à la Maison-Rouge que les gens comprenaient qu’il se passait quelque chose d’anormal. Maurice Orieux prit hospitalité chez nous d’abord, puis chez Nini Leray, à la Joustière, qui avait bien besoin de main-d’œuvre.
Louis voyageait beaucoup, soit chez les gars du groupe, soit en mission. Il me demanda un jour d’aller trouver Pierre Rialland. Je m’y rendis le soir avant souper. Les vagues de bombardiers, ce soir-là, ne cessaient de passer semer la mort et la ruine sur Nantes. Une auto, semant des tracts, passa dans le bourg de Joué. C’était des "Appels aux Français", leur demandant de rester neutres dans les combats qui mettaient aux prises anglo-américains et allemands. C’était quelques jours après le débarquement. (6 Juin)
Pierre n’était pas à la ferme. Sa mère me conduisit dans les champs. Nous traversâmes une prairie, bonne à faucher. Une explosion violente, suivie d’une fumée, au nord : c’était la gare de Châteaubriant qui recevait des projectiles. Nous cherchâmes longtemps, nous n’osions appeler. La mère Rialland fit aboyer son chien, simulant de le faire tucher les vaches, qui étaient sous la garde de son fils. Enfin, Pierre se montra. Il m’emmena dans sa retraite, dans le ravin du petit canal, au milieu des broussailles. Il me raconta qu’il avait prêté des armes aux gars de Belligné, et qu’ils refusaient de les lui rendre. Il avait eu une violente altercation avec Pierre, le chef de Belligné. Il me raconta également en détail la rafle où il faillit être pris.
Nous rentrâmes à la ferme où je fis connaissance des deux frères Templé, jeunes gens à l’air vigoureux. Pierre s’étant éloigné un instant, les gars me dirent quelle confiance ils avaient dans leur chef, c’était de l’admiration. Hélas ! de nous quatre, je suis le seul survivant ! J’ai les larmes aux yeux en écrivant ces souvenirs. Le père Rialland arrivant, nous fit des reproches de notre manque de précaution.
- "Cachez-vous donc, au moins. Si la police arrivait, elle vous emmènerait tous les quatre."
Je repris mon vélo et m’en revins, tandis que Pierre et ses hommes disparaissaient dans un grenier en attendant les autres. Je rapportais dans mes poches des balles de fusil demandées par Louis. Je me hâtais de rentrer, l’heure étant avancée, je ne tenais guère à être interpellé par les Boches. Que de fois j’ai admiré Pierre ! C’était vraiment un homme fait pour commander. Il avait un sang-froid admirable et un jugement sûr, une maturité au-dessus de son âge. Il avait eu certaines difficultés à établir son groupe. Le curé de Joué d’abord avait essayé de le détourner. Ne pouvant y parvenir, il avait mis en garde les jeunes de la J.A.C. contre la Résistance, en présence de Pierre d’ailleurs, qui sans doute après les réunions, détruisait l’effet des paroles de son pasteur. Il prétendait aussi que les gars de Joué n’étaient pas aussi faciles à mener que les gars des Touches. Pierre, avec sa patience et sa fermeté, avait surmonté ces difficultés et avait établi un groupe bien vivant.
En Juin, le pain manquait en différentes communes. Déjà, le sous-préfet était venu nous demander de hâter la livraison du blé contingenté. J’avais eu une discussion avec Pierre Martin, qui voulait garder les 7 quintaux qui lui restaient à livrer, pour les français.
Je lui assurais que le blé ne sortirait pas de l’arrondissement, que c’était un devoir de Le livrer. Il le fit à contrecœur. Et il avait raison, car quelques jours plus tard, une circulaire d’origine allemande supprimait toute attribution en farine aux communes rurales.
Le midi du 14 Juin, comme je dinais, le boulanger Foucaud arrive me chercher en auto pour m’emmener à la préfecture. Il était démonté, ayant refusé du pain à de nombreux réfugiés, qui avaient presque fait une émeute. Je m’apprêtais en vitesse. Et nous nous rendîmes à la Préfecture de Nantes, avec le maire. Nous vîmes M. Macé, chef du 5ème Bureau, qui nous dit qu’il ne pouvait rien pour nous, que nous devions nous suffire nous-mêmes, que le maire avait tout pouvoir de réquisition, de diminution des rations. Nous faillîmes rester à Nantes, notre auto ne voulant pas repartir. N’ayant trouvé aucun mécanicien, nous demandâmes à la remiser dans un garage. Le garagiste nous le déconseilla, les boches faisant, cet après-midi-là, réquisition des voitures. Nous la poussâmes dans une cour. Et nous revînmes à pied jusqu’à Carquefou où nous trouvâmes un camion qui vint nous amener aux Touches. Il était tard quand nous arrivâmes au bourg. Alphonse, venu voir si nous étions arrivés au bourg, m’apprit qu’un camion avec des soldats français était venu dans le village, demandant la Maison-Rouge. Cela me parut drôle et surtout compromettant. Arrivé à la maison, j’appris que c’était des gars de la Défense Passive, en réalité des résistants, et que nous avions réunion à la Maison-Rouge. Je soupais en vitesse, et me voilà parti avec les gars du village. Il faisait noir. Il y avait grande animation à la Maison-Rouge. Yacco, entouré des résistants qu’il avait amenés, des gars bien décidés, nous fit un petit discours. Il nous dit que le moment était venu de passer aux actes : nous allions entrer en maquis.
- "Je vous promets que vous n’avez rien à craindre, vous aurez des armes pour vous défendre, vous serez armés jusqu’aux dents. Demain, j’irais chercher vos armes. Vendredi, que tout le groupe vienne ici : vous serez nombreux et forts. Apportez une couverture, votre couvert, assiette ou gamelle, cuiller et fourchette. Ne dites à personne où vous allez, même pas à vos familles."
Je lui demandais si je devais rentrer au maquis, étant donné que j’étais astreint à suivre un régime, que, de plus, comme syndic, je ne pouvais guère abandonner la commune dans la situation où elle se trouvait, à la veille de manquer de pain. Louis m’appuya, disant que si je ne prenais pas moi-même en main la question du blé, la soudure ne se ferait pas. Étant donné les mille réfugiés que nous avions, la situation était vraiment inquiétante. Yacco répondit que je devais donner l’exemple et entrer au maquis, parce que cela ferait mauvais effet si je restais. Pour la question du régime, ce sera l’affaire des cuisiniers, quant à l’affaire du blé, il ne refusait pas que je sorte du maquis, selon les besoins de mes fonctions, à condition que je sois discret. Je répondis que si je rentrais au maquis, je n’en sortirais pas, de peur d’être espionné. Il me dit que nous arrangerons l’affaire vendredi. Il nous dit que nous ne serions pas en prison, que, dans le Midi, les maquisards se promenaient, allaient dans les cafés avec la mitraillette à la main.
Nous nous en revînmes enchantés, et un peu inquiets tout de même, nous demandant ce qu’allaient dire nos familles qui fallait bien prévenir. Nous étions arrêtés à causer sur la route, en haut de notre jardin. Nous causions bas. Nous entendîmes marcher sur la banquette. Arrivés près de nous, les causeurs s’arrêtèrent :
- "Qui va là ?", dîmes-nous.
Personne ne répondit. Nous demandâmes une seconde fois. Enfin un homme se montra. Il nous demanda la route des Touches, disant que les Allemands faisaient une rafle à Nort, qu’ils se sauvaient. Je les invitais à boire un coup, ils refusèrent et firent demi-tour. Dinand reconnut une espèce de brocanteur : il nous parut que nous avions sans doute à faire à des voleurs de lapins. Nous avions sauvé les lapins du village !
Le lendemain, il fallut prévenir nos parents. Cela ne leur fit point plaisir. Ils firent ce qu’ils purent pour nous détourner de notre projet, nous annonçant une foule de calamités qui ne manqueraient pas de tomber sur nous. L’après-midi, je m’en allais en réunion du Comité des réfugiés, à la mairie. Nous examinâmes la question des logements. Nantes avait encore été bombardée le matin. Le quartier de la Préfecture et de St. Pierre avait beaucoup souffert, on disait la cathédrale en flammes. Puis, on parla de la question du blé. Je dis qu’il n’y avait qu’un moyen de trouver les 60 quintaux qui manquaient pour faire la soudure : il fallait que le maire passât dans tous les greniers, sans exception, pour y évaluer les tas de blé, et prélever tout ce qui n’était pas nécessaire au récoltant.
Mon idée fut combattue, en particulier par l’adjoint, Baptiste Macé, qui voulait faire appel à la bonne volonté. J’avais déjà fait appel à la bonne volonté et fait faire une souscription, j’avais désigné des jeunes gens, dont Louis qui fit les villages du Meix et du Bois-Geffray : j’avais eu peine à trouver 20 quintaux. Je plaidais énergiquement pour l’adoption de mon projet qui seul convenait en la circonstance, et, en fin de compte, je l’emportais. Il fut décidé que le maire ferait la moitié de la commune, et l’adjoint l’autre, accompagnés d’hommes de différents villages, que je désignais. Comme je devais disparaître le lendemain, je voulais que les perquisitions commençassent le jour même. Je réussis à entraîner le maire à la Joustière, la Ducheté, la Martellière. Connaissant bien ces villages, je fis passer le maire dans tous les greniers capables de contenir du blé. Nous ne fûmes pas vus d’un bon œil dans une maison où on cachait un bon tas de blé pour les petits cochons, encore c’était chez un conseiller municipal !
Peu importe, l’affaire était en marche et le résultat était encourageant. J’étais harassé le soir quand Louis vint apporter l’ordre de partir de suite au maquis. Pour moi, je dis que je ne pouvais partir ce soir, je m’y rendrais dans la journée. Je me couchais et dormis mal. Les avions rôdèrent toute la nuit, j’étais persuadé qu’ils avaient parachuté des armes. Le lendemain, fête du Sacré-Cœur, j’allais à la messe, me confessais et communiais. Je réglais mes affaires, fis mes préparatifs et, après diner, je partis à travers champs à la Maison-Rouge, emportant une couverture et à manger, promettant de rentrer le soir pour contenter mes parents.
Le rassemblement de la Maison-Rouge n’était plus un secret. Au lieu de s’y rendre à travers champs comme nous l’avions décidé, des gars de Nort étaient venus par la route, secouant tous les voyageurs attardés. La ferme présentait une animation inaccoutumée. Je rencontrais les gars de Nort à l’ouest de la ferme. I y avait Aubry, ancien militaire, homme d’affaires, chez qui j’avais travaillé, Beaugeard, Guimbal, Hodé, Verger, Nauleau, Guihéneuf. Il y’avait des hommes partout, dans le cellier, dans la rue, dans les chemins. Le premier factionnaire que je rencontrais était le cher Cyprien Gougeon, il m’accueillit avec son sourire habituel. Je vis Louis, très sombre, peu communicatif, il n’avait pas l’air dans son assiette. Montant dans le grenier, je trouvais mes collègues syndics de Nort et de Petit-Mars, occupés à jouer aux caries avec des camarades. Ils avaient apporté à boire et voulaient m’en payer un coup. Le père Leray, le tôlier de Nort, faisait du rata dans la chaudière de la ferme. Une partie des gars de Nort partit peu après mon arrivée, sous prétexte qu’ils ne se sentaient pas en sécurité à la ferme. Il est vrai que nous étions mal gardés. Nous avions deux fusils-mitrailleurs, dont l’un était, sur la route à 100m. de la ferme. Les autres sentinelles avaient chacun un bâton. L’autre fusil servait à apprendre les hommes à en faire le maniement, ainsi qu’une mitraillette ou deux. Je me couchais une partie de l’après-midi, sous la grange, avec Pierre Rialland et ses hommes : Henri Moreau, les deux frères Templé et un quatrième. Comme je fis remarquer à Pierre qu’il n’avait guère amené d’hommes, il me répondit que les gars de Joué n’étaient pas aussi faciles à mener que les gars des Touches. Guihéneuf, de Nort, qui alla voir ce qui s’y passait, rapporta qu’on ne parlait que du départ des maquisards, On disait que c’était sur Les Touches qu’ils étaient allés, mais on ne savait pas où. Les Allemands eux-mêmes étaient au courant : le lieutenant avait demandé à Frémond, le tailleur : "Vous n’êtes pas parti au maquis ?"
Les domestiques de la ferme charroyaient le foin, aidés de plusieurs gars de notre groupe. Louis, toujours sombre, conduisait le convoi.
Voulant faire comme les camarades, je pris la garde à l’entrée de la "Grande Vallée". C’est Guihéneuf, l’instituteur de Nort, qui me mena relever la garde. Il faisait froid.
Néanmoins, je ne m’ennuyais pas trop durant les deux heures que j’y passais.
Je voyais les gens de Chaudron en train de faire des cosses dans leur prairie. Je me cachais derrière la haie pour qu’ils ne m’aperçoivent pas, Comme s’ils n’avaient rien vu d’avance ! Je mangeais les provisions que j’avais apportées, n’ayant pas voulu manger du rata à cause de mon estomac. Tous les quarts d’heure, un sous-off, révolver au poing, passait faire la ronde.
Un gars de Nort, qui, à 100m. de moi, gardait devant l’entrée de la "Petite Vallée", cherchait à me causer. Nous fîmes chacun la moité du chemin. Il me dit qu’il en avait marre et qu’il comptait déserter sitôt la nuit venue...
J’entendis un officier qui, monté sur le perron du grenier, faisait un discours, qui se termina par des applaudissements. J’attendais le retour de Yacco, absent, pour m’indiquer la ligne de conduite. J’étais décidé à suivre la proposition de Yacco, être dans le maquis sans y résider, faire mes fonctions syndicales. Un autre facteur m’inclinait à prendre cette décision : il m’en coûtait d’abandonner mes lapins angoras, ma seule ressource, je ne pouvais en laisser l’embarras à ma famille.
Les officiers tinrent conseil pour décider de l’établissement définitif du maquis. Les avis étaient partagés. Il était question de le laisser à la "Maison-Rouge". À vrai dire, l’endroit était peu propice. En fin de compte, sous la pression d’Aubry, il fut décidé que, la nuit venue, le camp allait être levé et transféré dans la forêt de Saffré. Quand je fus relevé, je revins assister aux préparatifs du départ. L’appel se faisait. Albert manquait. Henri Bourré, qui avait reçu quelques semaines plus tôt, un éclat d’acier dans un œil, avait, en charroyant le foin de la ferme, cet après-midi-là, reçu des poussières dans l’œil. Souffrant il avait obtenu un congé.
Quelqu’un était allé voir chez Albert si y était. On dit à ma belle-sœur qu’il serait porté déserteur. Inquiète, elle vint à la "Maison-Rouge". Personne ne l’avait vu. Décidé à rester, je dis que si Albert ne se retrouvait pas, j’allais partir à sa place. Quelques instants avant le départ, il arriva. Il dit qu’il était couché dans un pré. Il avait sans doute eu un moment de défaillance, comme en avaient connu tous les maquisards au cours de la journée.
Après les derniers préparatifs, un premier groupe partit par le chemin en direction du château de la Pécaudière. Je dis au revoir à mes camarades, promettant de me rendre à Saffré le dimanche suivant. Louis avait un fusil à l’épaule. Il semblait plus gai que l’après-midi, moins angoissé. Je m’en revins par les champs, le cœur bien gros. Le lendemain, je m’en allais aux "Braies" rouler le champ à choux, Des autos et une moto allèrent, puis revinrent de la Maison-Rouge. J’appris que plusieurs chefs étaient restés passer la nuit à la ferme, dans la crainte que les Boches ne viennent faire des représailles. J’évitais de causer avec mes voisins qui d’ailleurs, ne demandaient rien. Je n’appris qu’au moment du départ, que Pierre Martin avait demandé qu’on lui laissât tous ses domestiques plusieurs jours pour faire disparaître les traces de la journée, ce qui lui fut accordé.
Le dimanche suivant, je fus à la messe à Nort, puis je contournais la ville par les boulevards pour prendre la route de Saffré, excès de prudence ! IL y avait longtemps que je n’étais pas allé à Saffré. Et après être allé m’égaré aux fermes de Coëtzic, j’arrivais enfin à l’Étang Neuf. Je demandais à une fermière, qui attachait ses vaches, la route pour la ferme des Brées, croyant, avec raison, que le camp devait être par là. La femme me regarda et me dit "Vous allez voir Chauveau ?". Je répondis oui et, sur ses indications, je pris la direction de la forêt et arrivais au premier poste de garde.
C’étaient deux gars des Touches qui étaient là, dont un des frères Etienne, qui me conduisit au deuxième poste, à la barrière du chemin de la ferme. Il y avait là Henri Moreau, de Joué, et Métayer, un sergent, de Nort, qui me demanda de lui emporter un mot pour sa femme. Je rencontrais sur le chemin Albert et Dinand, en corvée d’eau. En arrivant aux Brées, je vis d’autres gars de Nort et des Touches. Le père Leray faisait sa cuisine dans la boulangerie, en face le PC, installé dans la maison du fermier ou du domestique d’Aubry parce qu’il était le fermier. Je vis Yacco. Il vint me saluer et me demanda d’attendre un moment pour lui parler. Il était vraiment l’âme du maquis : tout le monde avait à faire à lui. En l’attendant, je faisais les cent pas dans la rue (cour) de la ferme, causant aux uns et aux autres, qui tous paraissaient heureux d’être là. Ce jour-là, il faisait un temps splendide, très chaud. Pierre Rialland, tout endimanché, avec un collier de barbe, qu’il laissait pousser depuis que les miliciens lui avaient fait la chasse, vint au PC. Nous causâmes un brin. Je fis connaissance du vicaire de Bouvron, arrivé la veille avec ses hommes et ceux de Fay. Je m’informais de l’abbé Fleury : il me dit qu’il n’allait pas tarder à les rejoindre. Dans le grenier de la maison, deux femmes se poudraient la figure, elles avaient été faites prisonnières avec leurs amis, alors qu’elles se promenaient dans la forêt du côté du camp. Ces femmes, de mauvaise réputation, devaient rester prisonnières de peur qu’elles ne trahissent.
Yacco vint enfin me parler. Il me dit qu’il me fallait rester aux Touches pour assurer le ravitaillement du camp et le recrutement en hommes, que les syndics rendraient plus de services en dehors du maquis qu’au dedans. Il me présenta à Guimbal, ancien intendant des farines, que j’avais vu à la Maison-Rouge. Celui-ci me demanda si je pouvais lui fournir 10 quintaux de blé. Après quelques instants de réflexion, je le lui promis, de même qu’un veau que nous avions chez nous dont je discutais le prix. Ils devaient aussi enlever un charnier de beurre que nous avions salé, et qui provenait d’un camion enlevé à la laiterie de Bout de Bois.
L’heure de la soupe étant arrivée, je mangeais avec les cuisiniers. Une toute partie des hommes mangea non loin de nous, près de la mare, Quand j’eus fini de manger, j’allais avec eux, car c’étaient des gars des Touches : René, Pinus, A.Etienne, J.Bourgeois,etc.. Un avion étant venu à passer, on nous cria de nous camoufler : nous nous mîmes à l’abri de la haie très touffue. J’allais voir Albert qui montait la garde dans le chemin qui mène aux champs en allant vers le Pas du Houx. Il me parut avoir bon moral. Nauleau vint lui apporter son repas.
Le domestique d’Aubry, exploitant de la ferme, petit bonhomme ne payant pas de mine, était occupé, bien que ce fut dimanche, à faner ou râteler dans un pré, avec son fils, un gringalet de 18 ans. Ils vinrent causer avec nous. Je retournais au PC demander un laisser-passer à Yacco, qui était en train de donner congé aux "poules" et à leurs amis. L’un d’eux, nommé Carpentras, marchand de stylos, l’invitait à aller le voir quand il passerait devant la maison.
Roger Maisonneuve, pimpant et frais, vint dire à Yacco que les hommes rouspétaient en apprenant que les prisonniers allaient être relâchés.
- "Je n’entends pas que l’on discute mes ordres, répondit Yacco. Si je les relâche, j’ai pris mes garanties contre eux. Ils ne trahiront pas. Sils venaient à le faire, ils seraient fusillés. À défaut toute leur famille serait fusillée jusqu’à la troisième génération." ...
Ensuite, il me fit mon laisser-passer. Je quittai le PC, dis au revoir à tous les camarades qui se trouvaient là. J’eus le regret de n’accepter aucune lettre, tous voulaient m’en donner à emporter à leur famille. Yacco me l’avait formellement défendu. En repassant par la forêt, je visitais les cahutes où, dans la plupart, les gars étaient couchés à faire la sieste. Je vis les Goupil, Holner, les Etienne, Jean Etienne aussi et son commis, les gars de Doulon, Maurice Orieux et le petit Asiatique. J’allais voir Joseph Retière qui prenait la garde dans un passage en direction de l’Etang-Neuf. Je vis aussi des gars de Fay : je leur parlais de leur vicaire qu’ils attendaient. Je quittais le maquis, enchanté, regrettant de ne pouvoir y rester, et ne me doutant pas que, parmi tous ces jeunes gens pleins de vie, je ne reverrais plus plusieurs d’entre eux ! Au dernier poste, je montrais mon laisser-passer : c’étaient Pierre Hervé et un Templé qui gardaient Je trouvais à l’entrée de la forêt, la femme du domestique et sa fille en communiante, qui revenaient de la grand messe de Saffré : c’était la fête du Sacré-Cœur ou petite Fête-Dieu.
Devant une ferme de Nort, je rencontrais un gars des Touches, Massicault, de mon âge.
Contrarié, je dus arrêter à lui causer. Il me demanda sil était vrai qu’Albert était parti au maquis, que le bruit en avait couru, et même moi aussi, que l’on avait dit que le maquis était dans la forêt de Saffré. Je lui dis qu’il était vrai qu’Albert était parti, mais que j’ignorais où, que je venais du bourg de Saffré et que je n’avais nullement entendu dire qu’il y avait quelque chose dans la forêt. Pressentant une recrue possible, je l’interrogeais sur ses projets. Il me dit qu’il pensait un peu au maquis.
- "Si tu y penses, viens me voir un soir, nous n’allons pas tarder à savoir où est Albert, je pourrai l’expédier avec lui, si le cœur t’en dit".
Nous bûmes un coup dans cette ferme : personne ne parla de maquis.
Je m’en vins au bourg des Touches où j’assistais à la fin des Vêpres, Immédiatement après, eurent lieu les obsèques des parents, du frère et de la sœur de l’abbé Cheval, tués au bombardement du 15 Juin et ramenés aux Touches. Pendant l’enterrement, le curé de St.Malo-de-Guersac fit un discours sévère contre les agissements des "libérateurs". Pendant le discours, un convoi allemand vint à passer dans le bourg, et même s’arrêta. Quelques froussards, craignant le bombardement d’avions alliés, sortirent de l’église. À la sortie du cimetière, je rencontrais Maurice Bourré, qui me dit qu’il allait mettre ordre à ses affaires, et partir bientôt. Je lui dis : "Rien ne presse, prends ton temps : voilà un mois que tu es marié !" Je lui racontais mon voyage et lui dit que le maquis m’avait fait bonne impression. Le soir, j’eus la visite de Louis, non parti encore au maquis.
Le lendemain matin, lundi 19, avait lieu un service pour l’abbé Leduc, victime du bombardement. Monsieur le curé de Carquefou y assistait. Je lui causais après l’office, et lui dit que les gars étaient au maquis.
- "Où sont-ils " ?, me demanda-t-il.
- Je le lui dit.
- "Mais, si les allemands viennent les attaquer avec des tanks, pourront-ils se défendre ?".
J’avais l’impression que le maquis n’était pas très garanti, mais je me rassurais en disant que les boches étaient rendus trop loin, qu’ils n’auraient pas attaqué.
Le mardi matin, Louis vint nous faire ses adieux. Il devait partir le soir, emmenant Paul Orieux, Maurice Dauvé, dit "Lipus", autres domestiques de la Maison-Rouge, Maurice Bourré, Félix Guillet, Paul Tiger, Joseph Collard et Jean Godin. Il me demanda mes brodequins, qu’il m’avait payés d’ailleurs, "pour Félix Guillet", m’a-t’il dit, "qui n’a pas de chaussures", Je lui remis avec plaisir.
Le mercredi, nous eûmes la surprise de voir rentrer nos maquisards. De fâcheuses nouvelles d’attaque du maquis du Morbihan avaient décidé le commandant Philippe à licencier (?) le maquis de Saffré. Cela n’alla pas tout seul. Il eut une sérieuse discussion avec les officiers de là, Yacco, Guimbal, qui eux ne semblaient pas voir le danger. Ne furent renvoyés que les maquisards des environs, dont ceux des Touches. Cela fit beaucoup jaser. Cela ne changea rien, car je crois que la conversation générale ne roulait que sur le maquis.
Le jeudi, nous étions à faire la sieste sous la grange. Voilà qu’arrivent Louis et Francis Paitier,"Costaud", apporter l’ordre de repartir. J’allais porter cet ordre à René Milon, le domestique de la Fouquinière, Quant à Albert il alla à bicyclette, trouver Yacco à Safré, demandant un sursis, qui lui fut accordé, ainsi qu’à Dinand : leur instruction militaire étant faite. J’allais à la Maison-Rouge, le soir, souhaiter bon courage à Louis et à Paul Orieux, ne croyant pas que je ne les reverrais plus.
Pendant ce temps, le maire et l’adjoint faisaient la visite des greniers. Ils récupérèrent plus de 60 quintaux de blé, assurant ainsi le ravitaillement de la population d’ici la récolte, et me permettant d’en prélever 10 quintaux pour le maquis. Bien entendu, je mis le maire au courant, qui était d’ailleurs acquis à la cause.
Louis me fit dire qu’il serait bon que j’aille de temps en temps au maquis, pour faire la poste, car hélas, bien que ce fût interdit, tous les maquisards envoyaient des lettres chez eux. À la boucherie, quelqu’un demandant à Marcelle Etienne, la femme de Maurice Bourré, si elle avait des nouvelles de son mari, elle dit qu’elle en avait reçues le matin, devant tout le monde.
Je ne me pressais pas de retourner, ne voulant pas participer à ce que j’appelais une grave indiscipline.
Une auto du maquis était déjà venue chercher le charnier de beurre. Elle revint chercher un veau à la maison. J’avais voyagé pour acheter du vin, sans grand succès : le vin était rare et il ne fallait pas payer trop cher. "Condé" qui était donc là, voulait emmener du vin. Je montais avec eux, et je les conduisis au Château, chez Pierre Ferrand. Nous achetâmes une barrique de vin rouge, et il nous donna des patates. De là, nous allâmes à la Volerie pour acheter un porc chez Jean Leroux. Les cochons étaient "venus". C’était peut-être heureux pour le propriétaire, car mes gaillards étaient décidés à emmener un cochon, sans donner un prix de marché noir. Au moment de nous séparer, "Condé" me rappela : "Soulanges, je ne vous dois rien autrement ?" Je fis payer un panier de pommes de terre que j’avais expédié d’avance. Ils me donnèrent rendez-vous pour un autre jour.
Je cherchais du ravitaillement pour le camp. Je réussissais à intéresser les gens, même il me fut donné deux litres d’eau-de-vie pour nos gars.
Je devais conduire un groupe, le mardi soir 27 juin, au maquis, parmi lesquels Pitois, ancien domestique de Louis Fougère, et Maurice Macé, réconcilié avec sa mère. Lors de ma visite au maquis, j’avais eu commission de Maurice, de dire bonjour à ses parents et de leur dire où il était, sa mère se mit dans un tel état, que je regrettais m’être chargé de la commission. Je reçu une lettre de Pitois, me disant qu’il était désespéré, qu’ayant parlé de son projet à ses parents, son père l’avait menacé de ne plus le voir, et lui avait fait une scène terrible. Il me demandait de lui écrire une lettre menaçante, lui promettant un châtiment exemplaire au cas où il ne viendrait pas. Je ne voulus pas prendre cette responsabilité. J’écrivis à Louis, y joignant la lettre de Pitois. Sur ma lettre, je prêchais à Louis la modération, ayant vu les gars de Nort trop exaltés contre les collaborateurs. Je demandais également un sursis pour Bernard Leduc, qui semblait décidé à partir, mais voulait finir un travail. Je signais Soulanges. Et le lendemain soir, je m’en fus à la Maison-Rouge. Je n’avais que Maurice à conduire. J’hésitais à partir, le temps semblait devoir se mettre à la pluie. Je proposais au jeune homme de remettre au lendemain le voyage, mais il était décidé à partir dès ce soir, sa mère étant très bien disposée, il avait fait ses adieux à ses patrons. Nous partîmes, la bicyclette à la main. Nous devions aller à pied, mais Roger Maisonneuve ayant demandé qu’on lui envoya son vélo, l’occasion était toute trouvée. Nous descendîmes la prairie de la ferme en causant. J’étais décidé à rester coucher au maquis, si le temps était mauvais pour revenir. Nous évitâmes, autant que possible, de nous faire voir, à la traversée de la grande route. Mon compagnon avait un accoutrement semi-militaire : couverture, bidon, une musette. J’en portais une autre.
Nous arrivâmes au Pas-Durand vers dix heures du soir (solaire). Le temps s’était éclairci.
Nous nos arrêtâmes non loin de l’entrée du chemin qui mène aux Gouvallous. Maurice me dit qu’il rentrerait bien seul, au camp. Après réflexion, je décidais de m’en aller. Certes, j’avais à faire aux chefs, mais comme je n’avais pas de couverture pour le coucher au maquis, je décidais de m’en retourner. Je remis ma lettre pour Louis à Macé, et lui fit dire que le dimanche, je passerais la journée avec eux. Nous nous séparâmes. Il faisait un clair de lune splendide. Tout dormait au village du Pas-Durand. Je ne pensais pas que quelques heures plus tard, les fils Beloeil, réveillés par l’arrivée des camions allemands, se sauveraient, à demi-vêtus, à travers champs, pour gagner la Réauté ! En arrivant près du pont de la Fontaine, je rejoignis presque trois bêtes, chiens ou renards, qui s’en allaient à la queue-leu-leu, sans hâte, et disparurent dans la honcheraie. Je n’eus pas peur, mais un vague sentiment de frayeur. Je me couchais, il devait être près de minuit, et m’endormis aussitôt.
Le lendemain, je m’en allais au bourg, sans penser que mes camarades tombaient sous les balles allemandes. François Bourré, que je rencontrais dans le bourg, m’apprit que le maquis était cerné, qu’il avait vu passer à Petit-Mars, les camions allemands. Cette nouvelle me mit hors de moi. Je m’en allais à toute hâte. Combien je regrettais de n’avoir pas passé la nuit au maquis : mes camarades étaient au champ de l’honneur, et moi, j’étais à l’arrière ! Je courus à la Maison-Rouge, où l’on savait tout, sauf Mme Gonord, enceinte, et qu’on ne voulait pas inquiéter, par la porte du cellier ouverte, nous entendions des coups de feu. Nous ne savions hélas rien ! Je revins chez nous. Réunis par groupes dans le village, nous causions tristement.
Soudain, nous vîmes arriver Jean Bourgeois et un camarade. Nous courûmes voir. Ils nous dirent qu’ils étaient partis à travers les balles de mitrailleuse, et ce n’est qu’après bien des détours, qu’ils avaient pu échapper aux Boches, qui gardaient toutes les routes. Je retournais en hâte à la Maison-Rouge apporter la nouvelle. Cela ne disait rien pour les autres, mais ils disaient que beaucoup s’étaient sauvés. Le soir, Pierre Martin vint dire que de nouveaux échappés étaient arrivés à la Maison-Rouge. Malheureusement, je n’étais pas là, et quand je courus à la ferme, il étaient cachés dans le "Pré de l’étang". l’allais les retrouver. Il y avait Marcel Gonord, et Champagnat, le valet de Léontine, de St Mars-du-Désert, un boucher de N.-D. des Landes et un gars de Bouvron. Ils ne donnèrent pas beaucoup de détails, et ne purent me dire si Louis était sauf. Je crois même que Marcel émit des craintes sur son sujet. Il m’apprit que Maurice Macé, André Etienne et Alexandre Nerrière étaient à la Joustière.
J’étais dans une mortelle inquiétude au sujet de ma lettre. Je courus à la Joustière. Agnès me conduisit au lieu où ils étaient cachés, Nous trouvâmes là des bouteilles vides et un billet de Maurice Macé annonçant qu’ils allaient se cacher ailleurs. Je revins chez nous pour soigner.
Nous étions atterrés. Nous étions, sans doute, tous vendus, nos noms entre les mains des Boches, on allait sans doute venir nous prendre la nuit ! Nous fîmes coucher, tous les jeunes gens du village, dans une remise à foin, bien que nous nous demandions quel sort serait fait à nos familles si les Boches ne nous trouvaient pas.
Le lendemain, jeudi, le temps se mit à la pluie. Je portais à manger et à boire aux proscrits du "Pré de l’étang". Ils avaient peine à s’abriter de la pluie sous les haies heureusement touffues.
J’allais le soir à la Maison-Rouge chercher des papiers remis à Louis que la rumeur disait tué.
Nous ne voulions pas y croire. La famille Martin, sous les apparence d’un calme admirable, attendait l’heure de la vengeance nazie. Si des représailles devaient être exécutées, c’était bien par la Maison-Rouge que cela devait commencer ! Cependant, je couchais dans mon lit la nuit suivante, prêt à sauter par la petite fenêtre de plein-pied qui donnait sur le jardin, à la moindre alerte. Le lendemain, je retournais ravitailler mes gars. J’étais accompagné du copain à Jean Bourgeois, qui était resté là, et qui fut tout heureux de retrouver des camarades : Champagnat et les deux types de Bouvron et N.D.des Landes. Voulant s’en retourner, ils me demandèrent de les passer de l’autre côté de l’Erdre. Je leur donnais rendez-vous pour le lendemain à 3h du matin chez nous. Je dis que je les conduirais à l’Ile, et là, je trouverais quelqu’un pour les passer. L’on m’apprit que "Lipus" était rentré. Je passais le voir à la Maison-Rouge. Lui aussi pensait Louis mort.
J’appris que les maires, invités par l’autorité allemande, allaient reconnaître les morts sur le champ de bataille. Je grillais d’y aller accompagner le maire, et certes, j’aurais été bien utile pour reconnaître les victimes, mais je n’osais pas : c’eût été une trop grande imprudence de ma part.
Le samedi, je me levais à 3h, je mangeais et dus me recoucher en attendant les gars du "Pré de l’étang". Ils arrivèrent avec une heure de retard, sous la conduite de Marcel : ils s’étaient égarés dans les champs.
Vite, nous bûmes une goutte et partîmes avant que les gens ne soient levés, par le grand pré au bas du village (Gibé). Nous traversâmes les nôtres, les "Varennes", les "Laichets", "Douvres". Nous longeâmes le bois des "Vallons". Nous traversâmes la grande route avec précaution près du pont de Montigné. Nous passâmes près du hameau. Je demandais quelques renseignements à la veuve Dauvé, et nous suivîmes le chemin qui va des "Batisses" à la "Bruère". Au tournant, nous nous enfonçâmes à travers champs, pour tomber à l’Isle par derrière le village. Je laissais mes gars dans l’aire de F.Boudet, et fus trouver celui-ci chez lui.
Le père était là et vint trouver mes gars dans l’aire. Son fils se tenait caché. Je lui expliquais que je comptais sur lui pour passer les fugitifs en bateau. Il demanda à l’un des fils Doisy, ses voisins, de faire le passage. Comme nous discutions, nous aperçûmes une silhouette du côté du chalet Pouty. Comme instinctivement, nous nous baissions pour nous dissimuler, il nous dit "Ne craignez rien. C’est ma pauvre sœur qui est bien inquiète : son fils n’est pas rentré." Ma mission remplie, je me séparais de mes gars, à qui je souhaitais bonne chance, et m’en revins par le même chemin, De longues trainées dans les champs de blé annonçaient que d’autres étaient passés par là. La campagne était belle ce matin-là, mais le temps un peu couvert répandait sur elle une atmosphère de mélancolie bien de circonstance.
Je repassais près du bois de la Fraisaie aux vertes frondaisons. J’avais eu l’idée de faire traverser ce bois aux fugitifs. Heureusement que j’avais changé d’idée : des Boches furent aperçus dans ce bois, convenant assez bien pour faire un maquis. Je rentrais un peu fatigué, mais si heureux d’avoir aidé ces braves à se sauver, L’un d’eux, Champagnat me raconta, en chemin, qu’il état originaire de la Côte d’Or, et que deux de ses frères étaient dans un maquis du pays. Pour lui, ingénieur électricien à Pont-Château, il était venu rejoindre Saffré.
Dans la matinée, j’allais au bourg, et fus trouver le maire qui, je le savais, avait été la veille reconnaître les morts. Il m’apprit a mort de Louis et de Baptiste Rabin. Bien que je m’y attendais, je me mis à pleurer à chaudes larmes, comme je pleure encore en écrivant ces lignes : il me semblait que j’avais perdu un frère. Le maire n’avait reconnu que ces deux morts des Touches, et encore, il n’avait pu voir Louis, enfermé déjà dans son cercueil. À mon chagrin s’ajoutait l’inquiétude de ma lettre adressée à ce cher camarade et qui, je le craignais fort, devait être dans les mains des Allemands. Je n’avais pas revu Maurice Macé, et me demandais s’il avait eu le temps de remettre cette lettre à son destinataire. Ce pauvre Maurice était continuellement caché dans les champs avec André Etienne et Alexandre Nerrière. Ils avaient une peur de se faire prendre. Ce n’est que la semaine suivante que je pus joindre Macé, dans un petit chemin, près du Pont-Gérard. Je le tançais un peu pour l’inquiétude qu’il m’avait donnée. Le résultat de cette entrevue ne me tranquillisa guère. Il m’apprit qu’il venait de remettre ma lettre à Louis, qui prenait la garde au "wagon", qu’il avait commencé à la lire quand deux camions allemands avaient traversé la forêt sur la ligne (allée centrale), et qu’il l’avait sans doute mise dans sa poche pour aller prévenir le PC.
Le lendemain dimanche, presque tous les jeunes gens n’allèrent pas à la messe, tant la crainte d’une rafle et de représailles planait sur les esprits. Pour moi, je fus à la première messe. En allant, j’aperçus Emile Herbert dans un champ, se dirigeant vers la route. Je n’y fis pas attention. Ce n’est qu’à la sortie de la messe, que j’appris qu’il était allé prévenir les jeunes gens se rendant à la messe que des individus suspects étaient venus dans la nuit au Bois-Nouveau. Ils avaient demandé à manger et avaient parlé de la Maison-Rouge. Sans doute des miliciens... Le bruit s’en répandit dans la commune. Bien des jeunes et même des hommes âgés firent demi-tour, et il alla peu d’hommes à la grand-messe. Pour moi, je ne m’attardais pas trop dans le bourg. Mais, dans la matinée, je fus au Château. Là, je trouvais le fils Herbert et Jean David avec Pierre Ferrand. Nous allâmes même boire un coup au Bois-Nouveau où les types n’étaient plus là. Nous allâmes à la Chapelle. L’un des types était à la maison. Poussé par la curiosité, je voulus entrer, mais le père David, sachant à quel point j’étais compromis, me barra la porte, et je ne vis rien. On ne parlait que d’individus suspects rôdant dans la commune, hommes et femmes, cherchant à avoir des renseignements sur l’affaire de Saffré. Dans des champs de blé, au bord des routes, des trainées et des traces de gens qui s’étaient couchés derrière les haies, semble-t-il pour écouter les passants, ravivaient les inquiétudes.
Le lundi 3 Juillet, les journaux annonçaient que 27 maquisards de Saffré, qui avaient été pris le 28 Juin, avaient été fusillés par ordre des autorités allemandes.
Nous nous demandions si nous avions de nos camarades parmi eux. Ce n’est que les jours suivants que nous prîmes connaissance de la liste des fusillés, affichée à Nantes. Bien des noms étaient estropiés. Nous voulions espérer que nous n’avions pas trop de victimes, qu’il pouvait y avoir des maquisards du même nom. Il fallait pourtant nous rendre à l’évidence : cinq membres de notre groupe étaient parmi les victimes de la vengeance allemande : Joseph Retière, si aimable, André Holner, le domestique de Chaudron, alsacien bien français, Cyprien Gougeon, domestique de la Bonoeuvre, un garçon au caractère jovial, tous les deux copains et boute-en-train du maquis, Joseph Collard, un gars de 20 ans, et Paul Tiger, jeune homme plein d’espérance, ces deux derniers ne faisaient pas partie de notre groupe avant le maquis. Je serrais les poings de rage en pensant à cette terrible exécution. Comme d’autres, je voulais espérer que l’exécution n’avait pas eu lieu, que l’annonce en avait été faite en guise d’épouvantail. C’était bien mal connaître les Boches qui ne s’étaient pas contentés de tuer nos camarades, mais les avaient encore torturés auparavant. Nous ne savions combien de chez nous étaient tombés à Saffré. Seule la mort de Louis Loiseil et de Bste Rabin était certaine, cependant, bien peu étaient revenus. Le lendemain de l’attaque, 29 Juin, Maurice Orieux, Pierre Hervé et le petit asiatique de Doulon nous arrivèrent dans la soirée. Nous les restaurâmes de notre mieux. Ils étaient très inquiets de Paul Orieux qu’ils n’avaient pas revu.
Eux-mêmes étaient restés cachés toute la journée dans un fossé, et ce n’est qu’à la nuit, après avoir couru de grands dangers, qu’ils avaient pu s’éloigner de la forêt. Je leur conseillais de partir au plus tôt, craignant qu’une perquisition fut faite chez nous dans la nuit. Ils étaient fatigués pourtant. Je leur donnais un mot pour mon collègue de St.Mars-du-désert, M.Pageau, qui leur donna l’hospitalité, cette nuit-là.
Nous apprîmes que Baptiste Etienne avait pu se sauver après avoir couru de grands dangers. Maurice Bourré était sauf aussi, disait-on, et pourtant sa famille n’en savait rien. Un mort ayant été trouvé près de la Haudelinière et enterré au maquis, fut déterré ensuite et reconnu pour lui. Manquaient encore Félix Guillet et Jean Godin. Le premier ne devait être identifié que trois mois plus tard, au moment du transfert des corps aux Touches. Quand au second, mineur, il fut l’un des rares captifs non fusillés. Un mot de lui, envoyé de Compiègne, au moment de son transfert en Allemagne, vint rassurer sa famille, tout en la laissant dans de grandes inquiétudes sur le sort futur du jeune homme. Quant à René Milon, il revint un soir à la Fouquinière. Il avait eu une belle conduite au maquis et avait participé à protéger la retraite, faisant manœuvrer son fusil-mitrailleur jusqu’à l’ordre de repli. Le soir où il rentra, Albert et sa femme, Dinand, le père Leray qui se tenait caché à la Fouquinière, étaient couchés sur le foin dans le hangar de Jean Juguet. René, qui était accompagné de je ne sais plus qui, ils étaient plusieurs, entourèrent le hangar et se mirent à jargonner un charabia imitant l’allemand. Les dormeurs, réveillés en sursaut, eurent une de ces peurs dont on rit après, mais qui donne la chair de poule sur le moment.
Chez Albert ils fermaient la porte tous les soirs. Sa belle-mère et Irène couchaient chez leur voisine, la veuve Julien Leduc. Lui et sa femme, ainsi que Dinand, s’en allèrent coucher d’abord sous une espèce de tente, dans un pré, puis, ils allèrent à la Fouquinière, ensuite à la Duchetaie, chez Alfred Bourré, dans sa grange et aussi dans la chambre à Marie. Albert alla passer une semaine chez nos cousins Bernard, à la Gaubergère, en Couffé.
Pour moi, je couchais les premières nuits dans le grenier à foin des Bourgeois, puis, craignant que les Boches fassent du mal à mes parents en mon absence, je couchais quelques nuits dans mon lit, avec l’idée que, si l’on venait me prendre, je me sauverais par la petite fenêtre qui donnait de plein-pied sur ce lit. Puis, je recommençais à coucher sous les hangars avec les gars du village, et dans l’abat-foin de l’étable auprès de chez Albert. C’est dans cet écurie que nous avons fait plusieurs réunions avant le maquis. Nous avions beau mettre du foin, la couche se tassait, nous nous levions aussi fatigués que nous nous couchions. Avec Jean Bourgeois, je montais un vieux lit dans la maison aux patates, à l’autre bout du village, où nous nous couchâmes tous les deux, jusqu’à ce que le danger fut écarté.
La famille Martin était encore plus en danger que nous. Jamais ils ne quittèrent. Il était difficile d’abandonner la ferme. C’est miracle qu’aucune représailles n’ait eu lieu contre eux.
Peut-être faut-il attribuer ce relâchement de férocité habituelle aux Boches au fait qu’ils se sentaient moins forts. Ils n’ont pu, semble-t-il, ignorer les complicités du maquis. Sous une apparence de calme, Pierre Martin et sa femme ont vécu dans de grandes transes, décidés à vendre chèrement leur vie, avec les révolvers qu’ils avaient. Dieu soit béni de nous avoir si bien gardé !
Nous ne pensions qu’à une chose, jour et nuit, à cette affaire du maquis, à nos camarades morts. La conversation de tous les gens ne roulait que là-dessus. Je crois devoir rendre cette justice à mes compatriotes, c’est que tous tinrent leur langue devant les étrangers qui sillonnaient le pays. Les chefs du maquis nous avaient trahi, disait-on. Yacco avait été vu étendu, disait-on, le révolver à la main et du sang au poignet. Le lendemain, on l’avait vu revenir au maquis, avec Guimbal, en compagnie des Allemands. Et mille autres bobards semblables...
Voulant en avoir le cœur net, je décidais d’aller voir Pierre Rialland, qui s’en était tiré. Chargé par Yacco d’organiser la retraite, il avait pu rallier un petit nombre d’hommes et les sortir heureusement de la forêt, non sans dangers. Je partis le samedi soir, et eus la chance de le trouver là. Il me dit qu’il ne croyait pas Yacco coupable. Ce qu’il ne me dit pas, c’est qu’il était en relation avec lui. Peut-être ne l’était-il pas encore, ce n’est, je crois, que les jours suivants. Il me raconta son sauvetage. Nous parlâmes des manquants : il avait perdu Moreau et Templé, l’autre Templé devait rejoindre son frère dans la tombe d’une façon presque tragique, quelques jours plus tard. Il faisait presque noir quand je repartis. L’heure du couvre-feu était passée. Craignant de me faire ramasser par les Boches sur la grande route, je m’en vins à travers chemins à tomber sur la route de l’abbaye, au pont de la Chauvelière. Je m’embarquais par la minoterie du château où je tombais sur la route de Trans, au village des Auberdières.
J’avais étudié mon voyage sur la carte d’état-major avant de partir, mais ce coin autrefois était un bois, a été mis en culture et les chemins ont été changés. Je m’engageais sur la petite route qui mène à la ferme du Bois-Jean, croyant qu’un chemin, porté sur la carte, m’amènerait sur la route des Touches. Le Bois-Jean est une très belle ferme. Je pus en juger malgré l’heure avancée. Heureusement, il ne faisait pas très noir, les gens étaient couchés. Un gros chien voulut me dévorer. Je passais quand même, m’attendant que quelqu’un se lève pour voir ce qui se passait. Il n’en fut rien. Je m’engageais dans un grand chemin bien entretenu, qui s’en allait sur la gauche. Après avoir fait plusieurs centaines de mètres, je vis que ce chemin n’avait d’autres issues que dans les champs. Je m’y serais engagé en direction de la route, si je n’avais eu ma bicyclette. Je revins sur mes pas et repassais près de la ferme, pour continuer sur la droite vers le nord. Je ne fus pas plus heureux, et dus revenir par la cour de la ferme où le chien se mit encore à m’aboyer, mais moins vigoureusement que la première fois. Revenu à l’embranchement de la route, je réfléchis sur le parti à prendre. J’étais dans un lieu où je n’étais jamais venu. Devais-je, malgré l’heure avancée, revenir sur la route de Trans et gagner le bourg de Joué ou chercher une issue par des chemins inconnus ? Je me dis que sûrement un chemin devait aboutir dans le grand chemin de Trans à Nort, et je décidais de tenter cette chance. Je fis fausse route d’abord, par un petit chemin en cul-de-sac, dans lequel je me frappais la tête contre un poirier penché. Revenu dans le chemin central, je continuais à avancer vers le sud, ma bicyclette à la main. Je me sentais bien seul dans ce chemin perdu.
J’entendais tous les quarts d’heure sonner à Joué. Devant la barrière d’un champ, quelque chose de très blanc était étendu sur le sol, d’une blancheur presque éblouissante, du moins contrastant avec le noir de la nuit. C’était un carré de drap ou de peau de chèvre, posé là par qui ? J’avais bien envie de m’assurer de quoi il s’agissait, n’étant pas très peureux.
Et pourtant, une crainte instinctive me retint. Je passais à quelques pas, sans oser y toucher.
Enfin, j’arrivais dans le chemin de Trans et, delà, sur la route des Touches où je remontais à bicyclette et rentrais à la maison à une heure assez avancée.
Le lendemain, dimanche 9 Juillet, j’allais à la première messe aux Touches. Pierre devait venir me voir. Il m’avait dit qu’il irait à la messe à l’abbaye. En sortant de l’église, je ne fus pas peu surpris de le voir dans le bas-côté de l’église. Il n’était pas très connu aux Touches. En allant prendre sa bicyclette, nous rencontrâmes le commandant Lebannier et sa dame, pensionnaires de l’hospice. Nous causâmes de Yacco que ceux-ci connaissaient bien, puis l’abbé Cheval qui retournait à l’église. Comme au commandant, je lui présentais mon ami Pierre, et nous le chargeâmes de plusieurs intentions de messes qu’ils feraient célébrer.
Pierre resta une bonne partie de la journée. Le matin, nous eûmes la visite des maquisards de la région, René Milon, le père Leray, cuisinier, caché à la Fouquinière, les gars de Carcouët et ceux du village, puis, seul avec Pierre, nous allâmes dans notre pré des Varennes, où nous causâmes longuement. Je connaissais déjà Pierre, mais c’est surtout ce jour-là que j’admirais l’élévation de ses sentiments.
Au moment de l’attaque de la forêt, Pierre fut chargé de la retraite vers Vioreau. Il quitta la forêt suivi de nombreux maquisards. Pierre marchait le premier, en avant. Avec le sang-froid dont il a toujours fait preuve, il demanda qu’on le suivit sans crainte. Quelqu’un émit l’avis qu’il vaudrait mieux attendre la nuit pour sortir de la forêt. Pierre combattit cet avis, estimant que les Allemands ne manqueraient pas de fouiller la forêt. Ils étaient une cinquantaine quand ils sortirent de la forêt. Du côté d’Abbaretz, ils se dispersèrent par petits groupes. Pierre Rialland prit la direction de sa ferme avec une dizaine de gars. Non loin de la forêt, Pierre, s’avançant toujours le premier pour traverser la route, aperçut un peloton d’Allemands, qui heureusement ne regardaient pas de leur côté. Nos gars se terrèrent ou traversèrent plus loin. Ils arrivèrent avant midi à la Fortinière-des-Landes où ils furent reçus cordialement par la famille Rialland. Il en est qui pleuraient, ne sachant comment remercier leur sauveur, m’a dit depuis la bonne mère Rialland.
Bientôt commença la série des services d’octave pour nos camarades. Ce fut d’abord celui de Louis Loizeil. Nous nous retrouvâmes presque tous les anciens du maquis, sauf quelques peureux. Quand la grosse cloche sonna le service, et que je vis la famille Loizeil se rendre au service, la mère pleurant au bras de sa belle-sœur, le père avec son attitude attristée, mais si digne de résignation, je sentis mon cœur se fondre et eus les larmes aux yeux pendant tout l’office. Je crois bien que j’ai pleuré à tous les services et messes qui furent célébrés dans les semaines qui suivirent.
A la sortie du service, deux individus à la figure sinistre se trouvaient sur la place de l’église.
Immédiatement, la pensée de miliciens nous vint. Nous nous dispersâmes. Ils accostèrent le maire, qui venait du service, et lui dire qu’ils étaient des résistants et qu’ils lui donnaient l’ordre de réquisitionner une voiture pour les conduire à Ancenis. Le maire refusant poliment, s’attira cette réplique : "Vous êtes pour Vichy" et il lui firent des menaces. Finalement, ils réussirent à se faire emmener par Maxime David jusqu’au Pont-Esnault.
Depuis l’affaire du maquis, je n’avais pas revu Lorentz et son interprète. Je dis qu’ils comprendraient qu’ayant du sang entre nous, nous ne devions plus avoir de relations. C’était raisonner en mauvais connaisseur de la mentalité allemande. Dès avant l’attaque, ils avaient été voir le maire, cherchant à lui faire dire combien de jeunes des Touches étaient au maquis. Il n’avait, bien entendu, rien voulu dire. Ces messieurs partirent fort mécontents. Et le maire me dit de me tenir sur mes gardes, que contrairement à leur habitude, ils n’avaient pas dit un mot du syndic.
Le 14 Juillet, étant à couper du seigle chez nos voisins Petit-Bourg, dans le Grand Gué, ma mère vint me dire que les Allemands étaient là, me demandant, qu’elle avait eu envie de leur dire que j’étais absent. Après quelques secondes d’hésitation, je dis qu’il valait mieux essayer de ruser, et que ma mère avait bien fait de venir me chercher. Je trouvais ces messieurs assis près de la table. Nous échangeâmes des poignées de mains avec une apparente cordialité. Je fus chercher du vin à la cave, et nous causâmes de tout, sauf du maquis. Comme je dis de couper du seigle, ils me demandèrent de peser le grain de 4 gerbes et d’évaluer le rendement à l’hectare.
Enfin, avant de partir, l’interprète me présenta la liste des fusillés, me demandant si j’en connaissais. Je dis que je ne savais rien, que les prénoms n’y étant pas, je ne pouvais savoir s’il y avait des jeunes gens des Touches.
- "Dans les jeunes réfractaires affectés dans les fermes, est-ce qu’il en a été tués à Saffré ?", me demandèrent-ils.
- Je répondis que je ne savais pas, aucun décès officiel n’étant arrivé à la mairie.
- "S’il s’en trouve, vous nous préviendrez."
- "C’est entendu !", dis-je.
Ils s’en allèrent après avoir échangé avec moi de fausses amabilités.
Quand ils furent partis, ma belle-sœur, Berthe, me dit qu’ils l’avaient interrogée avant mon arrivée, qu’elle avait répondu évasivement, et qu’ils lui avaient dit en arrivant : "C’est étonnant que personne ne connaisse M. ., le syndic. Nous nous sommes égarés, nous avons demandé notre chemin à pas mal de personnes, personne n’a pu nous renseigner."
J’appris qu’ils étaient allés à la Martellière, au Vernay, me demandant à toutes les personnes qu’ils rencontraient. Personne ne voulut les renseigner, craignant que ce fut pour m’arrêter.
François Marchand seul leur indiqua. Il ne pensa pas me compromettre. Et en effet, s’ils avaient encore des doutes sur mon activité dans la Résistance, ils durent être convaincus, rien qu’à l’attitude de mes compatriotes. À partir de ce moment, je m’abstins d’aller à Nort, de peur qu’ils ne me fassent arrêter. Je me décidais pourtant à aller à la procession de N.-D. de Boulogne que nous allâmes chercher près de Tournebride, non loin du maquis, pour la ramener à l’église de Nort (17 Juillet).
Le dimanche 23 Juillet, dans la matinée, j’allais faire un premier pèlerinage aux tombes de nos chers camarades, avec François Bourré. Je fis un bouquet à l’attention de Louis. J’ignorais où se trouvait le petit cimetière. Munis de renseignements, nous allâmes par la Haudelinière.
Nous primes le grand chemin à gauche, que je connaissais bien. Après avoir tâtonné un peu, à travers champs, nous trouvâmes ce que nous cherchions. Nous fûmes bien émotionnés à la vue des treize petites croix. Nous déposâmes notre gerbe sur la tombe de notre ami commun, ce cher Louis, et nous priâmes pour le repos éternel des héros. Bien que ce fut pendant la grand-messe, Monsieur le curé de N.-D.des Langueurs était là avec d’autres personnes. Il évitait de se montrer en public, étant compromis. C’est ce qui explique sa présence ici à cette heure. Parmi les personnes présentes, un homme et une femme en grand deuil, à l’air triste, causaient avec le prêtre : c’étaient les parents du brave... , fusillé à la Bouvardière, venus faire un pèlerinage, sur Le lieu des derniers jours de leur héroïque enfant. Nous allâmes aux Brées. Quel changement s’était fait en ce lieu ! La fureur teutonne était passée par là : que de débris de toute sorte ! Je cherchais à retrouver une barrique et le charnier que nous avions expédiés : il ne reste rien après le feu !
Mme... m’interrogea pour savoir où était le bureau de son fils, qui était secrétaire. Je lui montrais la chambre de la ferme, dont il ne restait que les murs à moitié écroulés. Elle aurait voulu avoir des précisions sur lui. Hélas, je ne pouvais lui en donner. Je devais avoir par la suite l’occasion de revoir plusieurs fois cette dame, qui a le droit d’être fière de son fils.
Je fis visiter à François les cahutes, et nous nous en retournâmes par où nous étions venus.
Si je ne me trompe, ce dut être le 29 Juillet que j’eus la visite de Pierre Rialland. Nous étions à charroyer le blé. Il ne resta pas longtemps. Il ne voulut ni boire ni manger, avec sa sobriété habituelle. Il repartit bientôt. Il allait sans doute rejoindre son compagnon, Francis Paitier, avec qui il voyageait ordinairement. C’est eux qui avaient déposé, un soir, une gerbe au monument aux morts, avec l’inscription "A nos camarades, morts pour la France, on les vengera." Des personnes prudentes enlevèrent le lendemain, cette inscription. Je ne savais pas que je voyais pour la dernière fois Pierre. Je le croyais verni, il avait tant de sang-froid. Le...., les Boches vinrent installer un canon sur le Mont-Juillet, une DCA., disait-on. Ce qui ne faisait guère sourire les gens des environs. Puis, les Boches occupèrent le bourg et les environs, semblant vouloir s’installer pour résister. Il fallait donc s’attendre à voir la contrée ravagée. Ils restèrent quelques jours, creusèrent des trous. Ils paraissaient fatigués, disait-on.
Ils essayèrent de voler des chevaux, des harnais, des charrettes. Le maire, Monsieur Hodé, homme faible, leur résista fermement, malgré les menaces des officiers. Nous n’en menions pas large. Le matin du..., un camion allemand passa sur la route dans le village. Un des hommes demanda à Nanette "Monsieur ...", du moins, elle l’assure, malgré l’étrangeté du fait. Elle leur indiqua notre maison. Papa sortait dans le jardin au moment. Ils lui demandèrent la route de la Chapelle-Glain. Papa leur indiqua la direction de la route de Nort à Joué, et ils repartirent. Étonné de ce qu’ils eussent connaissance de mon nom, le soir venu, je m’en allais coucher à la Martellière. Comme je m’en revenais le matin, je n’entendais qu’un roulement en direction des Touches. Nous apprîmes bientôt que c’était les Boches qui déménageaient, et que les Américains étaient prêts d’arriver. L’après-midi, les gens de la contrée se portèrent en foule à Nort pour voir leur arrivée. J’y allais moi aussi. Nous ne les vîmes point. Mais des pelotons de Boches passaient, venant de la route de Blain et filant sur Les Touches, volant les bicyclettes pour se sauver plus vite. M.Viot, étant tombé de bicyclette, j’allais prévenir sa famille au château de la Pécaudière. Je rencontrais les L..., avec l’auto de leur patron. Ils étaient sept ou huit, armés. L’un d’eux, habillé en jaune, déployait le drapeau américain. Moi qui grillais d’aller désarmer les Boches au passage, je cherchais à les revoir pour m’embaucher avec eux, bien que je pensais dans mon souper. Pour eux, ils s’en allèrent assez loin sur la grand-route, firent plusieurs prisonniers boches avec leurs armes, du côté du Boulay. Je m’en allais à Nort, à la recherche de la troupe L...
Ne les y trouvant pas, j’allais à Vault où se trouvait le petit groupe, bien armé. On me mena voir les prisonniers boches, dans un logement à l’entrée du village. Ils ne s’en faisaient pas. Ils étaient trois, je crois. Ils me parurent bien plats, avec leur sourire hypocrite. Avec eux, on avait pris une sorte de mitrailleuse montée sur chariot. Inconnue des gars, l’un d’eux promit d’apprendre à s’en servir pour tuer ses frères. Je crois que c’est le russe, car il y en avait un. Ma commission faite, je m’en revins aux Touches. En passant au portail de la Bréchoulière, je vis des maquisards armés, dont plusieurs anciens de Saffré parmi des hommes à Cadiou transformé en commandant Joseph. Ils me demandèrent si je n’avais pas vu de Boches. Ils en attendaient pour les désarmer.
Aux Touches, le bourg était sous la domination des FFI. Réfugiés de la commune transformée, Fonteneau était commandant, Guillet et Moreau, lieutenants. Ce dernier prétendait remplacer le maire. Ils s’installèrent au patronage, où se faisait le recrutement.
Voir : Les Corps Francs Vengeance.
Ce jour-là, le bruit avait couru que Pierre Rialland avait été tué. Je n’y prêtait guère attention : cela avait été dit d’autres, et puis je le croyais immortel. (samedi 5 Août). Le lendemain, dimanche 6 Août, la nouvelle fatale fut confirmée : on avait recommandé aux prières, dans la chaire des Touches, notre pauvre camarade. J’en reçus un choc, mais sans analyser trop mes sentiments. J’allais à la messe de 8h. à Nort. Après M. Dugué me demanda d’aller chez lui, avec les personnalités de Nort, lieutenant de gendarmerie, Monsieur Blouard, de la Régie, Boudet, syndic de Nort, les boulangers et minotiers. Il s’agissait de prendre des mesures pour faire un pain moins noir, et aussi fixer le prix. Dugué agissait comme premier adjoint, remplaçant le maire Ganne.
En sortant, nous apprîmes qu’une colonne allemande se dirigeait sur Nort, venant de Sucé.
Les FFI se rassemblaient pour aller au devant. A la mairie, un chef énergique commandait. Il demanda deux volontaires. Je vis Roger Maisonneuve se présenter aussitôt, ce qui le releva dans mon estime. Je crois que, si je n’avais pas été en tenue, j’aurais été tenté fortement de suivre. Je rencontrais Georges Guillet. Nous allâmes jusqu’à la Sablonnais pour voir ce qui se passerait. Les larmes me tombèrent des yeux à la pensée de la mort de Rialland. Bientôt, les FFI revinrent, la colonne allemande avait changé de direction.
L’après-midi, j’allais voir le maquis avec Georges. Je ne connaissais pas bien le lieu où étaient tombés les gars des Touches. Je le découvris dans le champs d’ajoncs.
C’est le lendemain, lundi 7, qu’eurent lieu les obsèques de Pierre Rialland à Joué. Je passais aux Touches prendre une inscription pour une gerbe de fleurs. Nous nous trouvâmes presque tous les anciens du groupe. Jamais je n’ai vu un tel enterrement. Il y avait une foule immense.
L’église était pleine. Nous eûmes peine à y trouver place. A la fin de l’office, nous entendîmes du tapage au-dehors, coup de sifflet, bruits d’auto. Cela produisit un peu de panique dans l’église. Nous nous pressâmes de sortir. C’était des FFI qui arrivaient, dont le capitaine Aubry que j’allais saluer. Quand le cortège sortit, précédé de deux longues files de porteurs de gerbes, nous le suivîmes. Le porte-croix portait le brassard des FFI, c’était Lionel Gaillard, le fils de la propriétaire des Rialland, membre du groupe de Joué. Bien des gens pleuraient. Un discours fut prononcé, tous ne l’entendirent pas, et pourtant, ce fut un déluge de larmes, on entendait les sanglots, je ne sais pas s’il se trouva des assistants ayant les yeux secs. Le père Rialland adressait la parole à tous ceux qu’il connaissait, avec un sang-froid très digne.
Quand je lui tendis la main, il dit : "Voilà les gars des Touches, les camarades de mon Pierre. Je veux vous voir à la sortie pour causer avec vous." Je me hâtais de serrer la main aux autres membres de la famille, et me sauvais en sanglotant, et c’est en pleurant que j’écris encore en ce moment (23 Septembre 1945).
A la sortie du cimetière, il nous retrouva et nous dit ce qu’il savait. Pierre était parti avec Yacco et Mauras, le jeudi sans doute. Ne rentrant pas, la famille était inquiète. Le samedi, on leur dit qu’on avait trouvé un jeune homme tué du vendredi, sur la route de Teillé, démuni de papiers et qu’on s’apprêtait à enterrer. Le père reconnut son Pierre. Les trois FFI avaient débouché sur un peloton de cyclistes allemands, des officiers. La route n’étant pas droite, ils ne les virent pas tous. Yacco ordonna le feu. Les Allemands ripostèrent. Nos trois combattants essayèrent de traverser les haies. Yacco et Maurras y parvinrent, l’un de chaque côté de la route. Quant à Pierre, blessé, il fut achevé de plusieurs balles. Les Boches lui enlevèrent sa montre, son portefeuille, etc. Yacco et Maurras se sauvèrent à travers champs, chacun se croyant le seul rescapé.
Cette mort me fut extrêmement pénible. Celle de mes camarades de mon groupe l’avait bien été aussi, mais je n’avais pas perdu Pierre, qui me semblait verni. Je le sentais fort, clairvoyant. J’aimais à m’entretenir avec lui de l’avenir de la Patrie.
La semaine suivante, un service solennel était célébré, à Teillé, à sa mémoire. Je ne pus y aller. Albert, Dinand, B.Etienne, Pierre Martin s’y rendirent. A l’issue de la cérémonie, une longue procession s’achemina sur le lieu de la mort glorieuse de Pierre, où fut béni un calvaire fraîchement élevé.
J’avais fait le sacrifice de ma vie, et espéré mourir pour la Patrie. Je voyais arriver la fin de la guerre avec tristesse de ne pas avoir été choisi. C’est alors que, plus que jamais, l’idée de me faire brancardier me domina. Un soir de battages, nous entendions la canonnade du siège de Nantes. Je brûlais d’envie d’y aller pour ramasser les blessés sous la mitraille. Cette idée me transportait, ce soir-là. Pierre Martin vint nous voir en passant, il revenait d’un enterrement d’un cousin, à Carquefou, Bourgeois, tué au moment de la libération de ce chef-lieu de Canton. Il voulait remplacer Louis, chef de groupe, par B.Etienne. Pour moi, je pensais qu’il ne devait plus y avoir de groupe aux Touches, la place de ses membres étant sur le front.
J’enfourchais ma bicyclette et allais voir B.Etienne, lui demandant, s’il voyait Yacco, de me proposer comme brancardier. Ce soir-là, j’avais travaillé dur, en battant, il faisait chaud, j’avais bu un coup, et étais un peu exalté. Je regagnais ma cagna, que je n’avais pas encore abandonnée, et m’endormis avec l’espérance que je servirais la France effectivement.
Le 20 Août, j’assistais au service des morts du maquis, célébré dans l’église de N.D. des Langueurs. Une nombreuse assistance composée d’anciens, d’amis et des membres des familles, remplissait l’église. Une délégation de FFI formait une garde d’honneur autour du catafalque. Au début de l’office, Yacco, entrant dans l’église, attira tous les regards. Après l’office, la foule stationna sur la place. Nous serrâmes la main de Yacco, accompagné de sa dame mise avec chic. Pour lui, il avait maigri, on le disait atteint de la poitrine. Chacun gagna, par ses propres moyens, le hameau du Pas-du-Houx où se forma le cortège processionnel. L’absoute fut donnée devant les tombes. Yacco prononça une allocution d’une voix mal assurée, et fit l’appel des morts en estropiant les noms. Je cherchais à voir Yacco pour mon projet, mais ne pus y parvenir dans la foule. Il repartit aussitôt. Je fis connaissance des parents de Moreau, et fis visiter le maquis à la famille Rialland de Joué.
Dimanche, une grande cérémonie devait avoir lieu à Nort. j’allais voir le rassemblement sur le champ de foire, mais je me tins à l’écart du cortège où étaient mes camarades des Touches.
En tête, marchait un peloton de soldats du Commandant Joseph, alias Cadiou, qui s’intitulait commandant de la place de Nort. Dans la foule, je causais avec un de ses hommes, qui me dit que le commandant était, ce matin, à voir le colonel Félix, que pour eux, ils se battaient dans la forêt du Gâvre. Je lui demandais si on employait des brancardiers. Il l’ignorait. Pour moi, je me serais aussi bien engagé avec eux qu’avec Yacco. Il me semblait que tous les combattants ne devaient avoir qu’un idéal : libérer le sol français du joug de l’allemand. J’assistais à la messe de huit heures, dite pour nos morts, debout devant une porte, tant il y avait de monde.
Après eut lieu le défilé au monument aux morts. Le coup d’œil était impressionnant à la vue de la foule immense qui se pressait dans la rue pour honorer nos morts glorieux. Le Dr.Tardiveau parla, et un instituteur laïque aussi, dont le discours prononcé d’une voix bien timbrée, ne me plut pas cependant. L’après-midi, les hommes de Nort étaient invités à se rendre au maquis à bicyclette. Ils y allèrent nombreux, et un certain nombre de mes camarades les accompagnèrent. Le Cdt.Joseph y prononça un discours, selon ses opinions et ses aspirations de communiste. Yacco parla aussi. Pour moi, sous prétexte de prévenir nos camarades de l’enterrement de nos morts qu’on devait ramener, je partis, cet après midi-là en direction d’Héric où je comptais les trouver avec Aubry. Arrivé à Héric, le bourg était plein de soldats, surtout d’américains. Je me rendis à la mairie, où un FFI me dit qu’Aubry et ses hommes étaient à Fay. J’hésitais à m’y rendre : il faisait chaud, j’étais fatigué. Il y avaient là des gens de Nort, que je connaissais un peu. Ils y allaient pour voir un cousin soldat. Je décidais d’y aller moi-même. Des autos américaines ne cessaient de traverser le bourg. Je parlementais avec un conducteur, en montrant un brassard de FFI dont je m’étais muni, mais il me fit comprendre qu’il n’allait pas à Fay, et de fait, aucune voiture américaine ne nous dépassa. À mi-chemin, nous vîmes une batterie d’artillerie installée dans les champs. Des avions ne cessaient de sillonner le ciel. Le bourg de Fay était très animé par les soldats.
Beaucoup me connaissaient et vinrent me serrer la main. Je les prévins que les gars des Touches, enterrés à Saffré, devaient être transférés aux Touches, et que les obsèques auraient lieu le mercredi suivant. Ils dirent qu’ils viendraient, toute une délégation, s’ils le pouvaient. Je vis le capitaine Aubry, sa dame et ses demoiselles. Je m’offris comme brancardier. Le capitaine me dit : "C’est bien ! Mais il m’en faut deux. Tu vas voir le major, c’est lui que ça regarde." Je vis le major, qui revenait de la limite du front. Il me dit qu’en un certain endroit critique, les gars n’étaient pas rassurés du tout, et qu’ils tremblaient comme la feuille, qu’un sous-off. avait fait plusieurs attaques de nerfs. "Je vais lui sonner les cloches", dit Aubry, qui ne se démontait pas. Mme Aubry me dit séparément qu’ils n’étaient pas assez nombreux, que les Américains ne les soutenaient guère, et que tout français tombant entre les mains des Boches était massacré. Je causais au major, homme très froid, très distant, qui ne m’encouragea pas. Il me proposa d’aller à St.Mars la Jaille, je passerais une visite de santé et je serais incorporé où l’on m’enverrait. Ceci ne faisait pas mon affaire. Étant donné mon état précaire, je n’étais pas sûr d’être admis. Ensuite, on m’eut envoyé sans doute dans un hôpital militaire, alors que c’est au front seulement, sur le champ de bataille, que je voulais servir. Je m’en revins découragé. J’étais seul, mes compagnons de l’aller avaient dû se rendre jusqu’à Joué pour voir leur ami. Je pensais à mon précédent voyage, de quelques mois plus tôt, avec Louis. Et j’enviais son sort. La Providence ne permettrait pas que je verse mon sang pour la Patrie !
Le.., je conduisis les prêtres des Touches en pèlerinage au maquis. Ils étaient accompagnés de M..., réfugié de St Malo. Nous partîmes à bicyclette, par Vault, le Pas-Durand où nous allâmes voir la ferme Beloeil, où les prisonniers du maquis avaient séjourné dans la cour pendant la journée tragique du 28 Juin. Nous fûmes bien reçus par ces braves gens. La famille se composant de la mère et des trois ou quatre fils, je connaissais l’un d’eux, Jean. La mère nous raconta qu’au bruit des camions, le matin du 28, ses grands fils s’étaient sauvés, à demi-vêtus, jusqu’à la Réauté. C’était certainement heureux pour eux. Toute la journée, la ferme fut occupée, et la mère Beloeil dut faire la cuisine pour les Boches autoritaires et menaçants. Les prisonniers, amenés dans la cour, les mains attachées derrière le cou, étaient sous la garde de trois soldats, le fusil braqué sur eux. Dans un coin de la cour, furent brûlés les objets pris aux captifs. L’endroit du foyer nous fut montré, de même que divers objets qu’elle avait trouvés : plusieurs chapelets, une plaque militaire au nom de Holner. La brave femme avait donné l’un de ces chapelets au vénérable directeur de l’école St. Michel. Elle nous offrit les deux autres. M. le Curé en accepta un. L’abbé Cheval et moi refusèrent l’autre, bien que j’en eus envie, mais je dis à cette brave femme de le garder pour elle. Nous empruntâmes la ligne jusqu’auprès du Pas-du-Houx où nous laissâmes nos vélos. Le père Doucet était à ramasser des poires. Il nous parla lui aussi de la mémorable journée, les mauvais traitements reçus, l’enlèvement de son petit-fils et de son jeune voisin. Je lui demandais une barre de fer pour planter une petite croix de bois, au lieu de la mort des gars des Touches, dans le champ d’ajoncs. Cette petite croix, je l’avais apportée à bicyclette.
Albert l’avait fabriquée. Je la conserve comme un précieux souvenir. Nous allâmes nous agenouiller et prier devant les treize tombes. Nous y fîmes rencontre de M. et Mme Trochu, tailleur à Nort, accompagnés de leur jeune fille, Ces MMrs. des Touches firent connaissance avec cette famille. Le frère de M.Trochu est prélat de Sa Sainteté et écrivain de renom. Nous entrâmes dans le champ d’ajoncs. Puis, je plantais la petite croix que M. le Curé bénit. J’écrivis dessus :
Ici, deux jeunes français ont versé leur sang pour la Patrie, 28 Juin 1944.
Je croyais, à ce moment, que seuls, Loizeil et Rabin étaient morts là.
À mon voyage suivant, le mot "deux" avait été remplacé par le chiffre "quatre". Toujours accompagnés de la famille Trochu, nous visitâmes les ruines des Brées, puis les cahutes.
Le lendemain, mardi 29, avait lieu l’exhumation de nos quatre morts, enterrés dans le champ du Pas-du-Houx : Loizeil, Bourré, Rabin et Guillet. Ce dernier, c’est seulement à ce moment qu’il fut reconnu par sa famille.
Les quatre cercueils, ramenés le soir, furent déposés dans la première classe de l’école, où trois d’entre eux avaient reçu des leçons de patriotisme de notre bon maître, M.Sevet, et où, à son tour, Maurice Bourré l’avait enseigné. Toute la nuit et la journée du lendemain, les gens du pays, les camarades des héros, vinrent veiller et prier dans cette chapelle ardente.
Les obsèques eurent lieu le mercredi 30 Août, à 4h. du soir. Le temps sombre, pluvieux, était à l’unisson des cœurs. Les corps furent portés par leurs camarades des Touches et de Nort.
Un grand nombre de gerbes et de couronnes nécessitèrent de nombreux porteurs. Une délégation de FFI venus de Fay, selon la promesse du capitaine Aubry, formait une escorte d’honneur. Les familles placées dans le transept gauche, les enfants des écoles et la foule remplissaient complètement les trois nefs de l’église. Un cantique de circonstance fut exécuté à la tribune par la chorale sous l’habile direction de l’abbé Cheval, cantique qui impressionna tous les assistants. M. le curé de N.D. des Langueurs et M. le vicaire de Saffré étaient venus apporter leur sympathie aux familles des victimes. Le défilé se déroula lentement vers le cimetière, avec station au Monument aux Morts de la guerre où le maire, M. Hodé, lut un discours très bien dans son ensemble, mais d’une voix saccadée, sans tenir compte des arrêts usités dans les phrases. Le Dr. Tardiveau prononça lui aussi un bref discours. Après quoi, les cercueils furent enlevés et transportés dans le cimetière. Pendant les discours, arriva une auto d’où descendirent des FFI en uniforme, parmi lesquels des gars de notre groupe, Métaireau, Lipus, J.Etienne, partis le matin s’engager au camp de Yacco, à Riaillé. Après les condoléances et les dernières prières, la foule se dispersa. Je trouvais les parents de Pierre Rialland, devant le café Retière, avec Pierre Martin et Léontine. Ils vinrent, malgré le mauvais temps, faire un pèlerinage à la Maison Rouge et chez nous en souvenir de leur Pierre. Pour moi, pendant la cérémonie, j’étais dans une disposition d’esprit tout autre qu’aux précédentes cérémonies. Je crois bien que je ne versais pas une larme. J’étais fatigué, découragé.
Petite Histoire de balles
Il faillit m’arriver une histoire avec des balles. Louis Loizeil avait confié une grande quantité de balles à Albert Judic pour être nettoyées par celui-ci, en les emportant, la boîte s’ouvrit, elles s’éparpillèrent sur la route, il lui fallut les ramasser une à une au risque d’être remarqué des passants.
Revenant du bourg Judic me demanda de remporter les balles qu’il avait rendus reluisantes, j’étais bien chargé déjà de quoi je ne me souviens plus, il me remis une grande boite ficelée assez lourde, à la sortie du patronage, je rencontrais Pierre Ferrand père qui revenait du bourg en voiture, il me demanda de passer chez lui y prendre des boudins je crois, il me dit donne moi donc une partie de tes bagages, je lui donnais ceux qui n’étaient pas attachés et sans réfléchir la boite de balles, il pris par le Bois-Nouveau et moi je filais par la route, en déposant la boîte dans la voiture elle rendit un son métallique qui je crois ne dut guère tromper le transporteur sur le contenu.
Arrivée au Château avant la voiture, je causais au fils Pierre occupé à rentrer les foins avec les trois réfugiés de la Martellière, le père Legoff et ses gendres, hommes sûrs, mais que je ne connaissais pas tout de même, je m’empressais de récupérer le précieux colis à son arrivée, mais voila le fils pris de curiosité qui voulait voir ce qu’il contenait, je réussis pourtant à l’empêcher devant ses hommes, l’un d’eux remarquant mon embarras, détourna la conversation et l’attention de Pierre de la boîte objet d’une curiosité que je trouvais peu de mon goût.
Je me promis d’être plus circonspect à l’avenir quand je transporterais des objets aussi compromettants.
Résistants avec nom d’emprunt et quelques noms connus de Résistants
Résistants avec le nom d’emprunt dans la Résistance
- Général Audibert, chef de la Résistance dans l’Ouest : "Bertrand"
- Les cinq Délégués Militaires Régionaux (D.M.R.) envoyés par Londres pour la Loire-Inférieure :
- Commandant Willk : "Olivier"
- Commandant Barthélémy : "Barrat !"
- Capitaine Paul Cyr (américain)
- Capitaine Philippe Ragueneau : "Erard"’
- Lieutenant Pierre Gay : "Christian Lejeune"
Quelques noms connus de Résistants sur le secteur
- Colonel Valentin Abeille : "Fantassin" et "Lecourbe"
- Jacques Chombart de Lauwe : "Colonel Félix"
- Colonel Meunier : "Dewar"
- Colonel François-Jacques Kresser-Desportes : "Kinley"
- Commandant René Terrière : "Xavier Dick"
- Henri Bouret : "Jean-François"
- Michaud, chef départemental de l’A. S. : "Dariès"
- Dr Dupé, est pourvu du titre de Régional Maquis
- Colonel Pierre-Louis Bourgoin : "Le Manchot"
- Commandant Félicien Glajean : "Philippe"
- Colonel Paul Chenailler : "Morice"
- Commandant Jean Coché : "Jules Cottin"
- De Briac Le Diouron : "Yacco"
- De la Bourdonnays Yves : "Norbert"
- Lieutenant Jean-Pierre Dautel, agent de liaisons
- Roger Fonteneau : "Commandant Henri"
- Commandant Maurice Guillaudot : "Yodi"
- Maurice Guimbal : "Capitaine Maurice"
- Robert Cadiou : "Commandant Joseph"
- Roger Meaude : "Maillard"
- L’Abbé Ploquin : "Surcouf"
- Pierre Marionneau : "Pierrot"
- Lieutenant Merlet : "Morand"
- Michel Guiriec : "Yannick"
- André Mauras : "Condé"
- Brozen : "Legrand"
- Rebattet : "Cheval"
- François Lollichon : "Mazarin"
- Maurice Dauvé : "Lipus"
- Pierre Rialland : "Vauban"
- Francis Paitier : "Costaud"
- Georges Deleuze : "Georges"
- Louis Loizeil : "Marceau"
- Edmond Jaunasse : "Soulanges"
 | Se connecter
|
Plan du site |
| Se connecter
|
Plan du site |